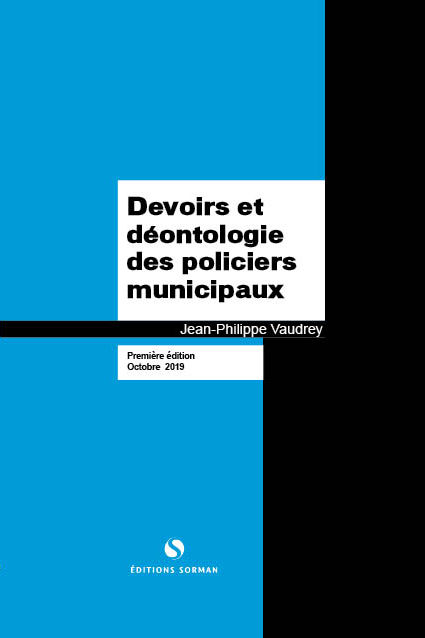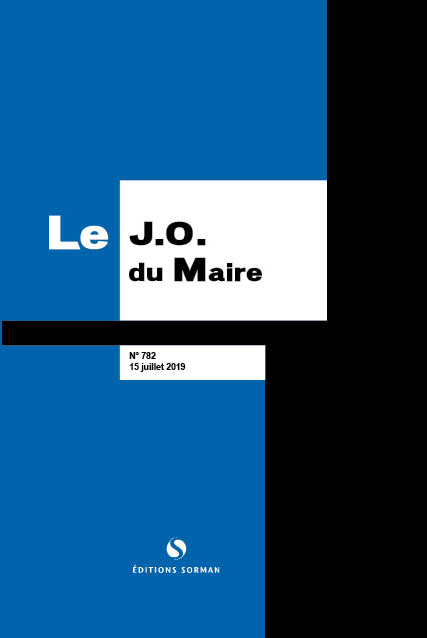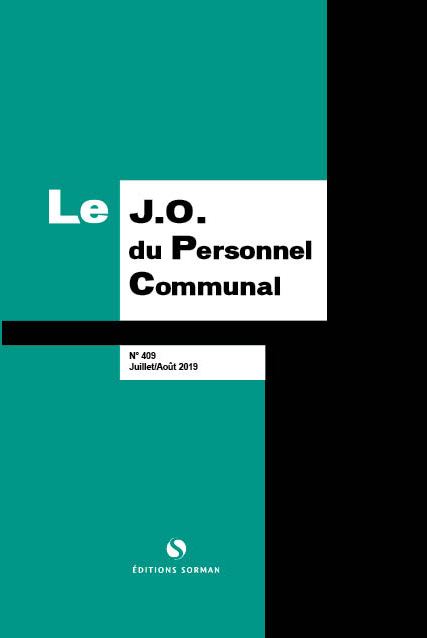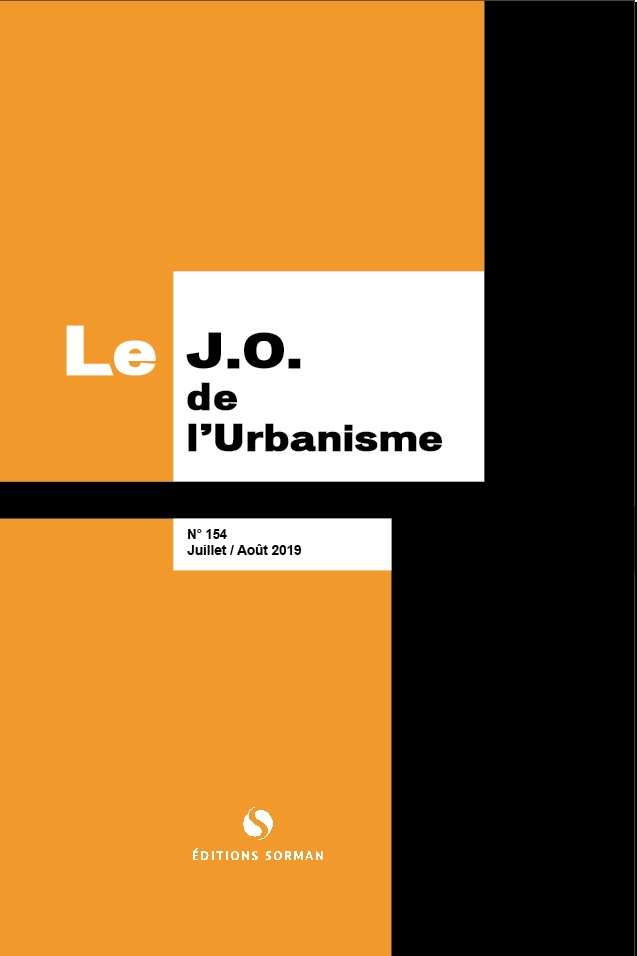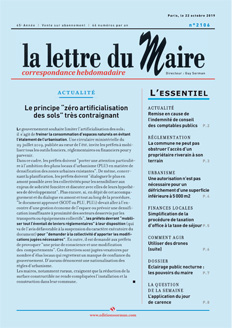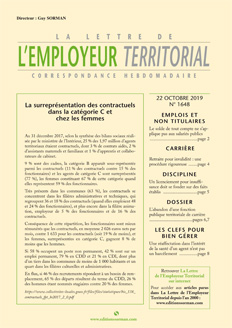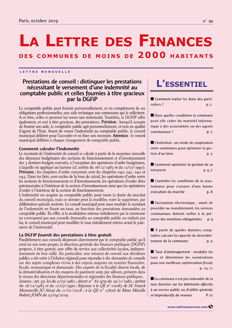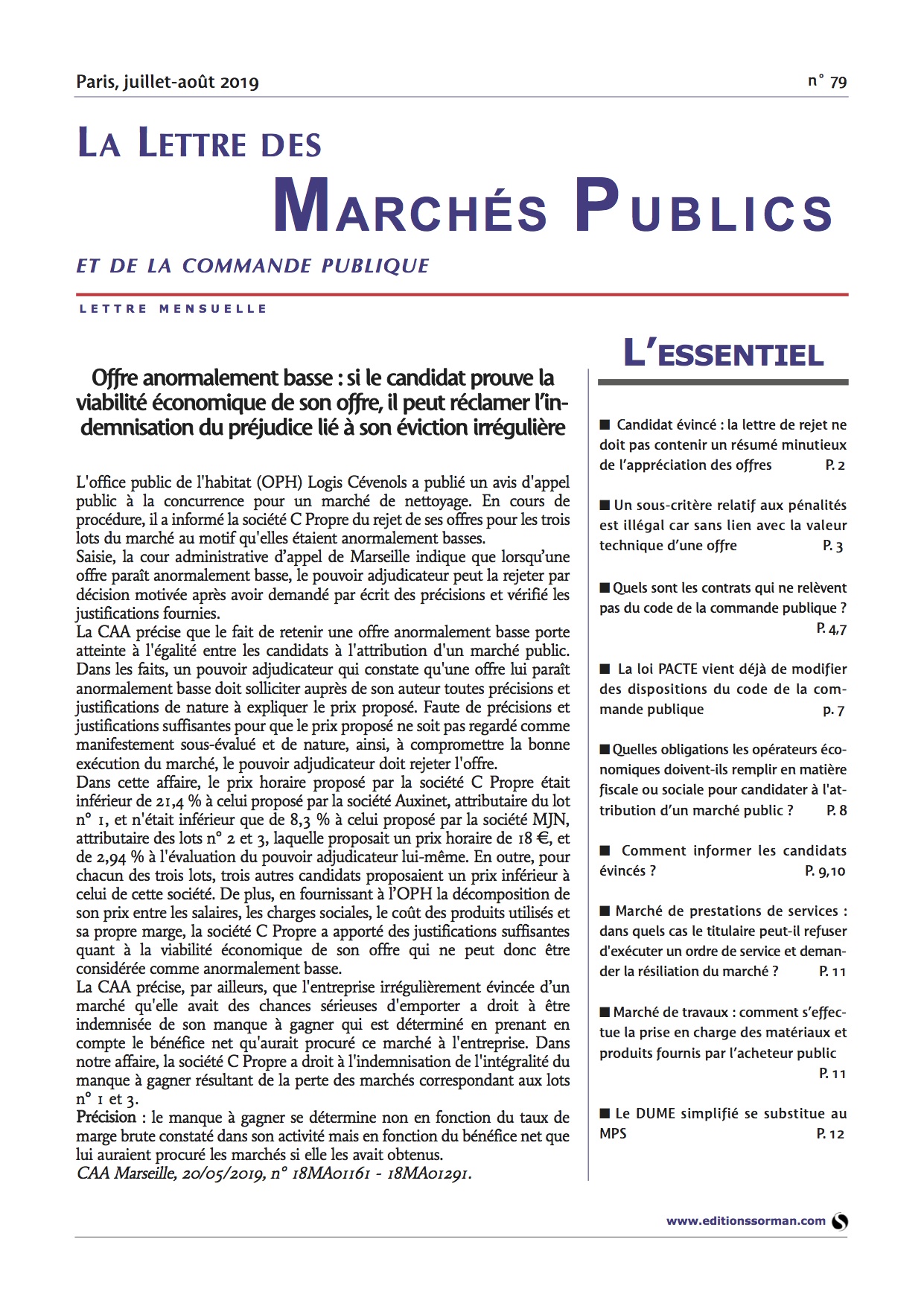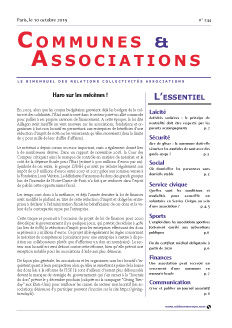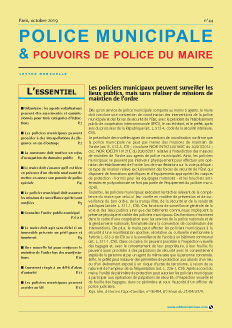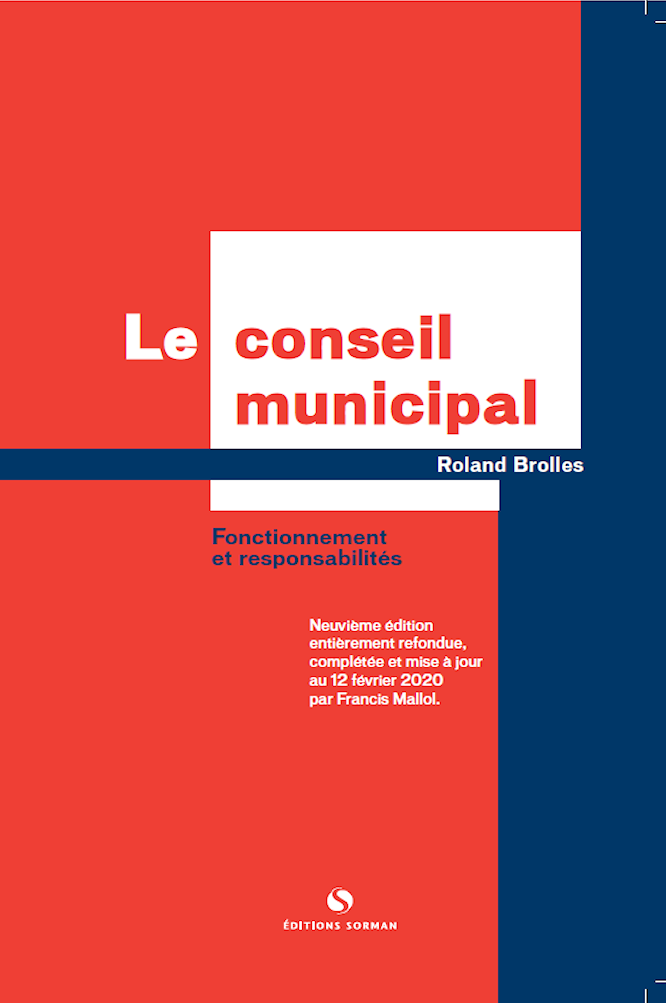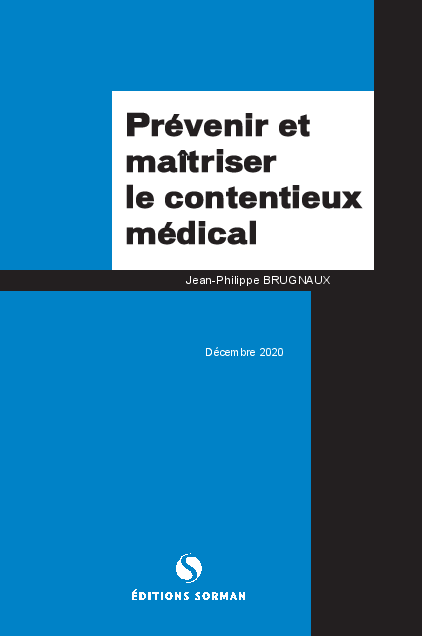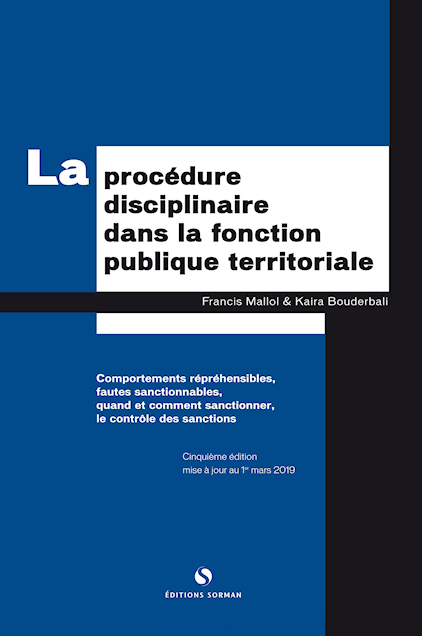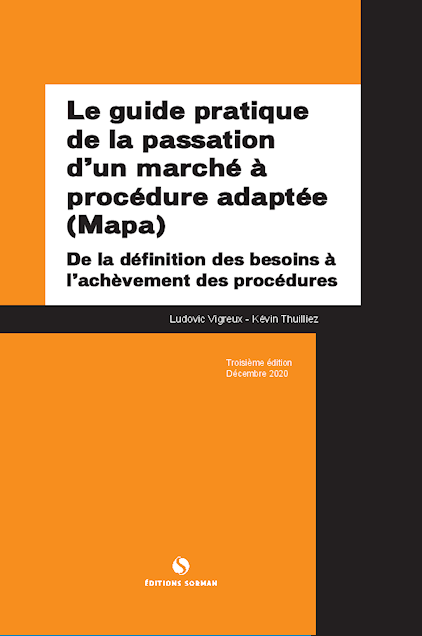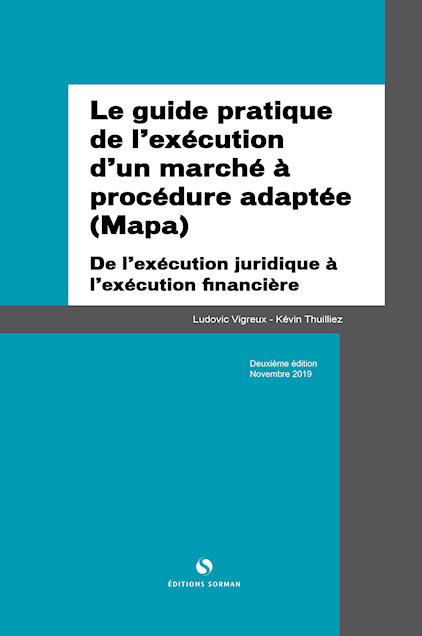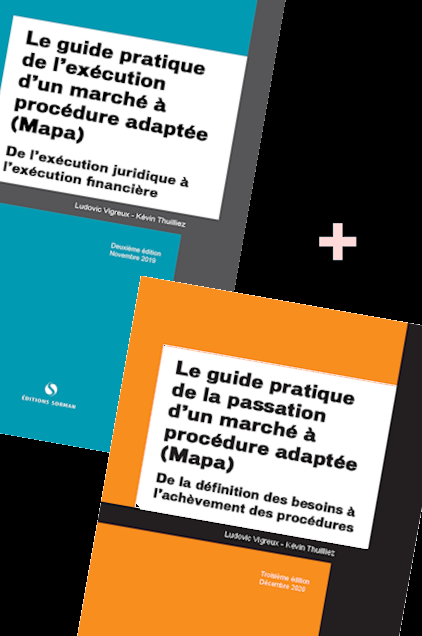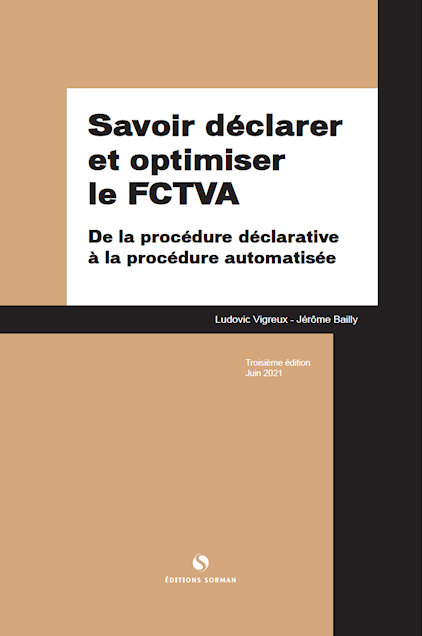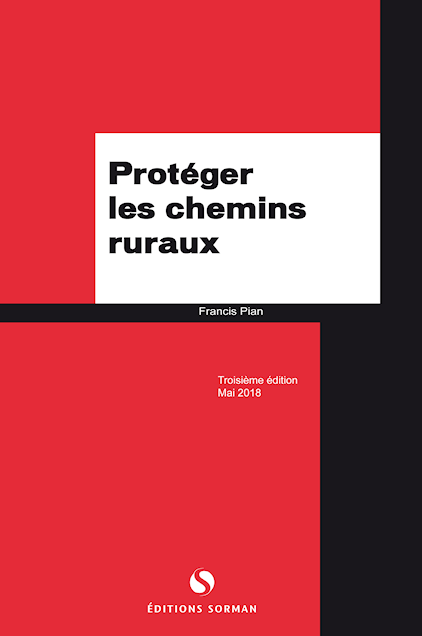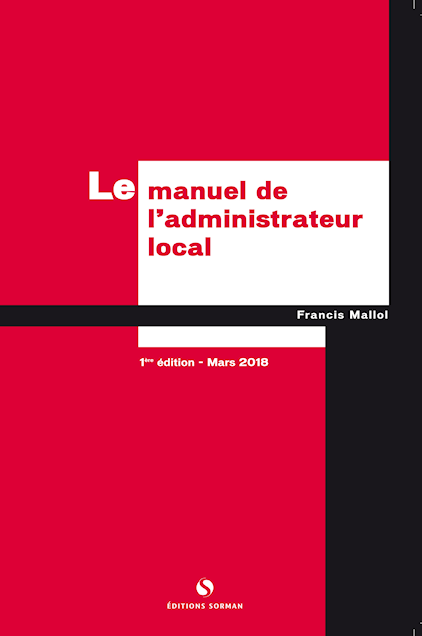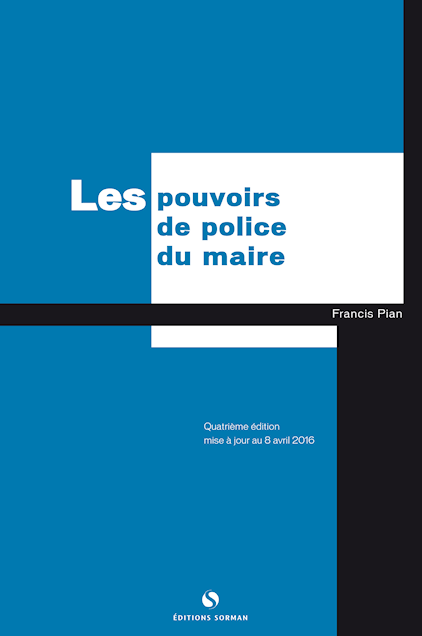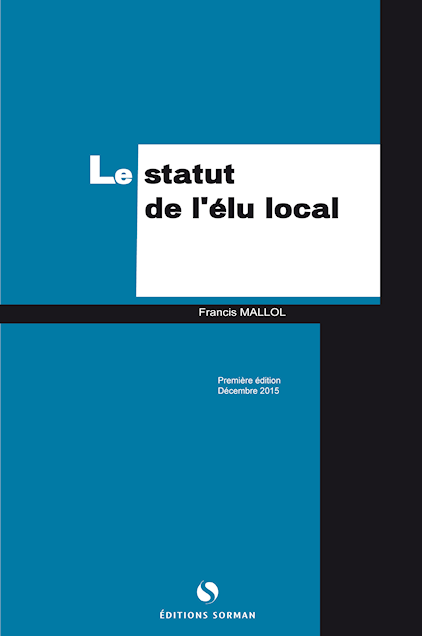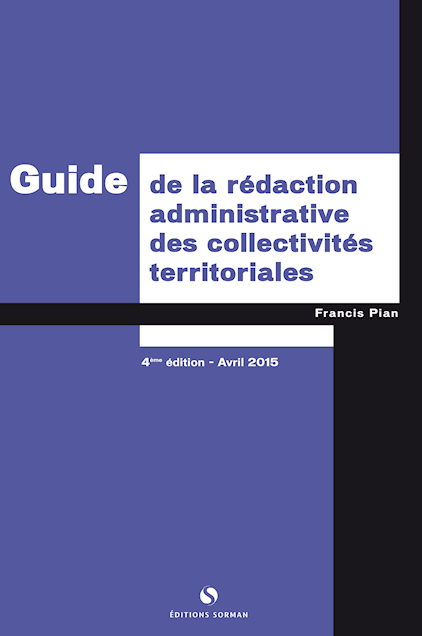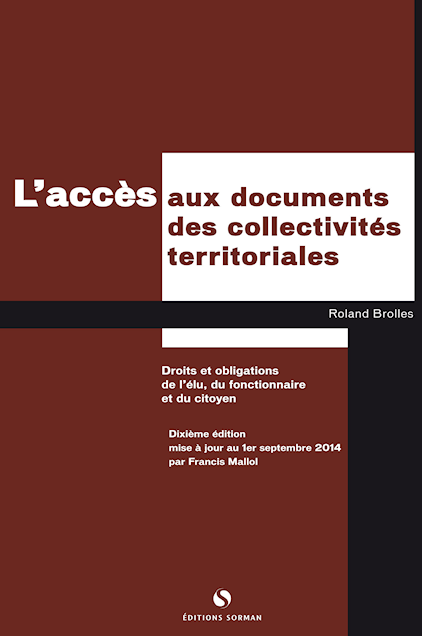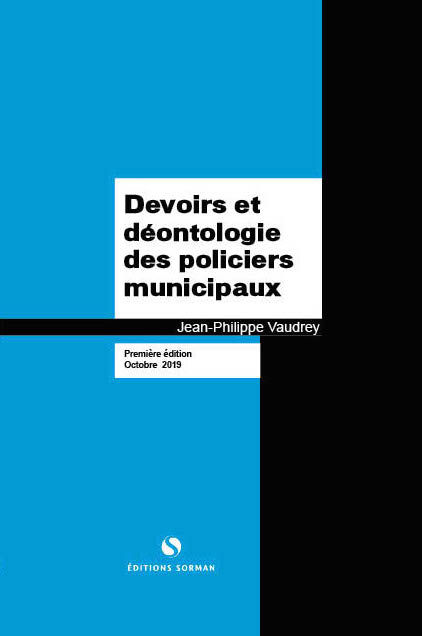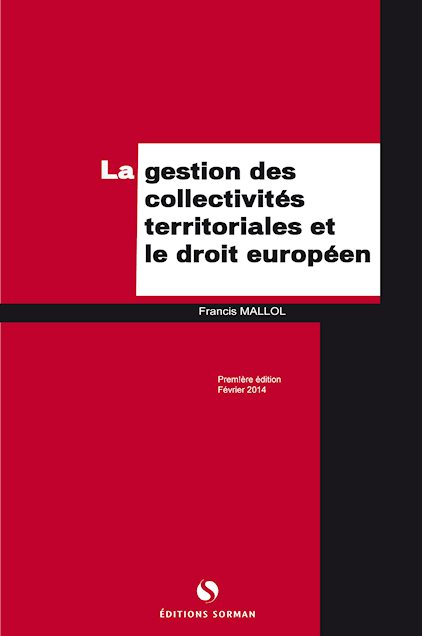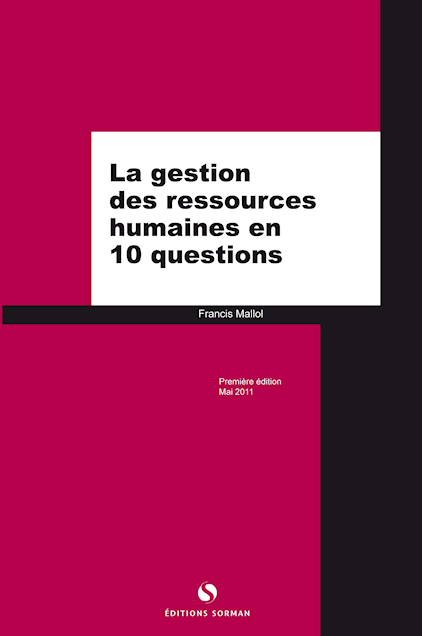Réduire les dépenses avec la méthode du « Budget à Base Zéro » Abonnés
Le « Budget à Base Zéro » : une méthode inspirée du secteur privé
La méthode du « Budget à Base Zéro » a été inventée par Peter Pyhrr dans les années 60 ; il l’a mise en œuvre successivement chez Texas Instruments et dans l’Etat de Géorgie. Selon Peter Pyhrr, « le Budget à Base Zéro est un procédé de planification et de budgétisation qui exige de la part de chaque dirigeant d'un centre de décision qu'il justifie dans le détail, et dès son origine, tous les postes du budget dont il a la responsabilité, et qu'il donne la preuve de la nécessité d'effectuer une dépense ».
Le « Budget à Base Zéro » repose sur une justification de chaque dépense dès l’ouverture d’un nouvel exercice ; cette méthode se distingue du budget de report qui consiste à repartir du budget de l’exercice précédent et l’ajuster en fonction de ses contraintes budgétaires.
L’objectif du « Budget à Base Zéro » : détecter et éliminer les dépenses inutiles
On comprend mieux l’intérêt d’une telle méthode dans la construction des budgets locaux, surtout au moment où l’Etat veut contraindre les collectivités territoriales et leurs établissements publics à réduire leurs dépenses. Oubliés les « contrats de Cahors » qui visaient à limiter l’évolution des dépenses du secteur public local, l’Etat veut désormais faire contribuer les collectivités locales à la réduction du déficit et de la dette publics en les contraignant par l’évolution de leurs recettes.
La recherche de l’équilibre budgétaire (principe qui ne souffre aucune exception) et le financement des dépenses d’équipement nécessiteront la diminution des dépenses de fonctionnement, qu’il s’agisse des charges de personnel ou des charges à caractère général.
C’est dans ce cadre que les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont tout intérêt à s’inspirer de la méthode du « Budget à Base Zéro » qui permet de réinterroger chaque dépense et d’en juger l’utilité au lieu de reconduire systématiquement les lignes budgétaires d’exercice en exercice.
La méthode à suivre
Au lieu de reconduire des lignes de crédits, et pour préparer les arbitrages, chaque service sera invité à :
- différencier ses différentes activités et les décrire en termes quantitatif et qualitatif ;
- classer ses différentes activités par niveau de priorité. Le classement s’effectue selon les priorités politiques de la majorité municipale ;
- établir le budget minimum pour réaliser chaque activité ;
- déterminer des variantes pour faire évoluer chaque activité en nombre ou en qualité ;
- chiffrer ces variantes et mesurer les écarts entre le budget minimum et les variantes.
Cette méthode permet certes d’identifier les dépenses inutiles, mais également les dépenses en « doublon », par exemple l’achat d’un même matériel par différents services alors qu’il pourrait être mutualisé. En partageant ce travail avec le service achats/commande publique, il permettra de regrouper les commandes de fournitures et prestations identiques faisant l’objet de procédures distinctes.
Notons qu’il est également nécessaire :
- de qualifier chaque dépense afin d’identifier les dépenses obligatoires des dépenses facultatives ; on peut également parler de dépenses de structure et de dépenses d’action.
Le caractère obligatoire d’une dépense peut résulter des compétences obligatoires de la collectivité ou des dépenses que chaque collectivité a l’obligation d’engager en vertu de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
- de mettre en évidence les dépenses subventionnables. La suppression d’une dépense entraînera en effet la perte d’une recette.
Vigilance sur les dépenses d’investissement générant des coûts de fonctionnement induits
En matière de dépenses d’équipement, chaque service doit identifier les éventuels coûts de fonctionnement induits. Par exemple, la construction d’un nouveau bâtiment génèrera de nouvelles dépenses de fonctionnement sur les exercices suivants, faisant ainsi peser de nouvelles contraintes sur les budgets futurs.
Les principaux coûts de fonctionnement induits sont les suivants : les charges de personnel, les fluides, les maintenances, les assurances, les fournitures nécessaires au déroulement des activités…
Olivier Mathieu le 18 février 2025 - n°2351 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline