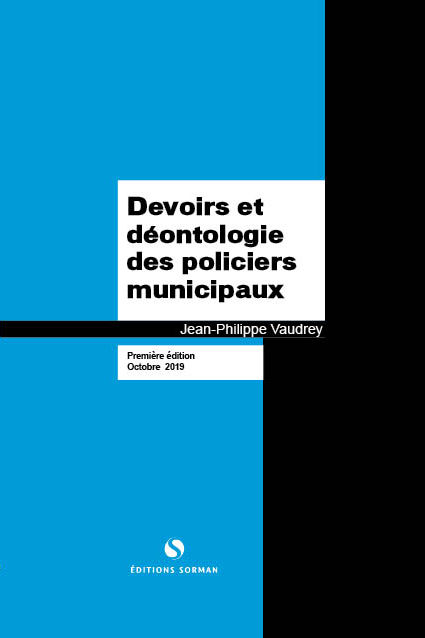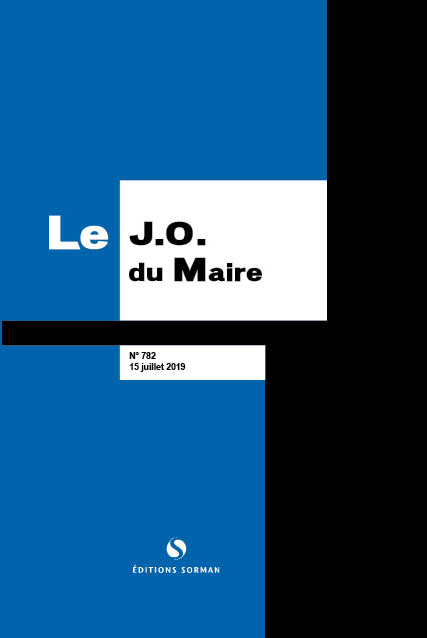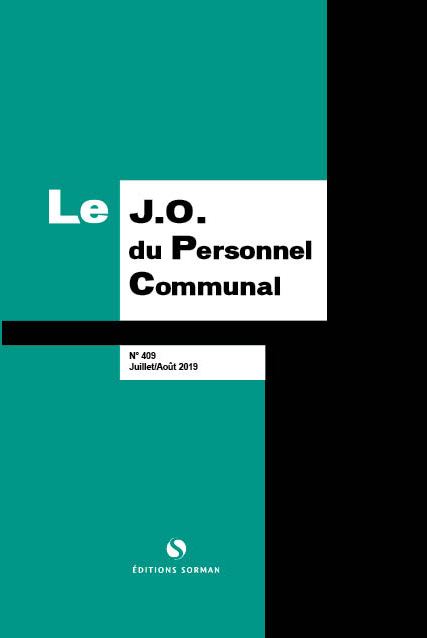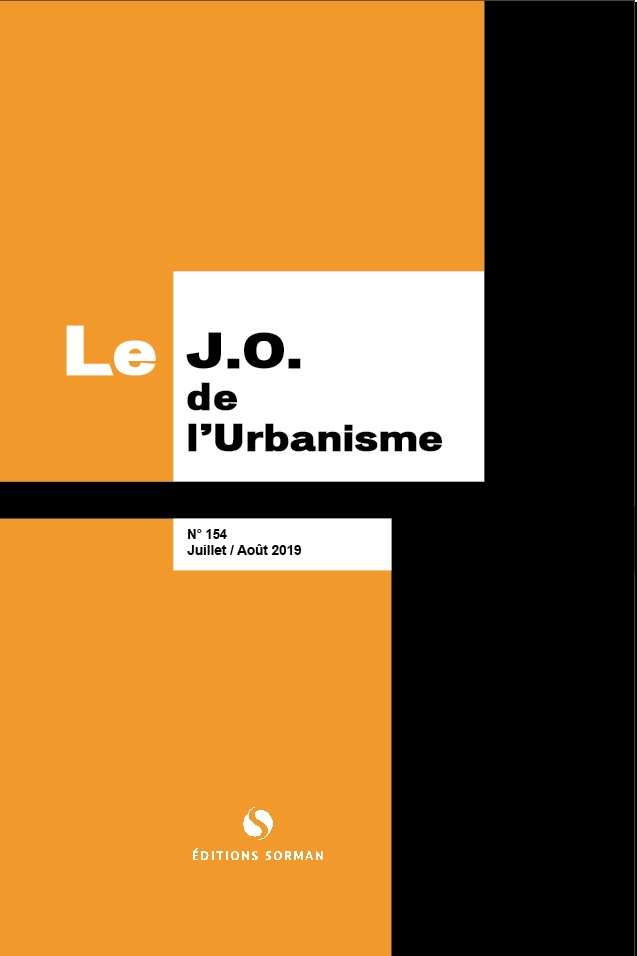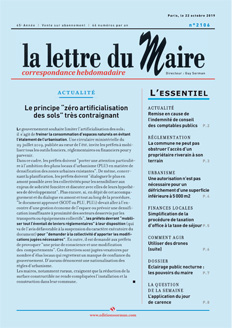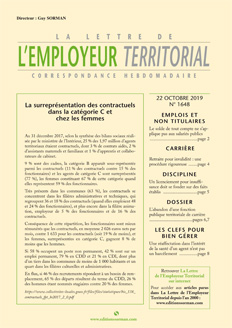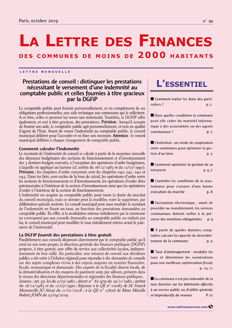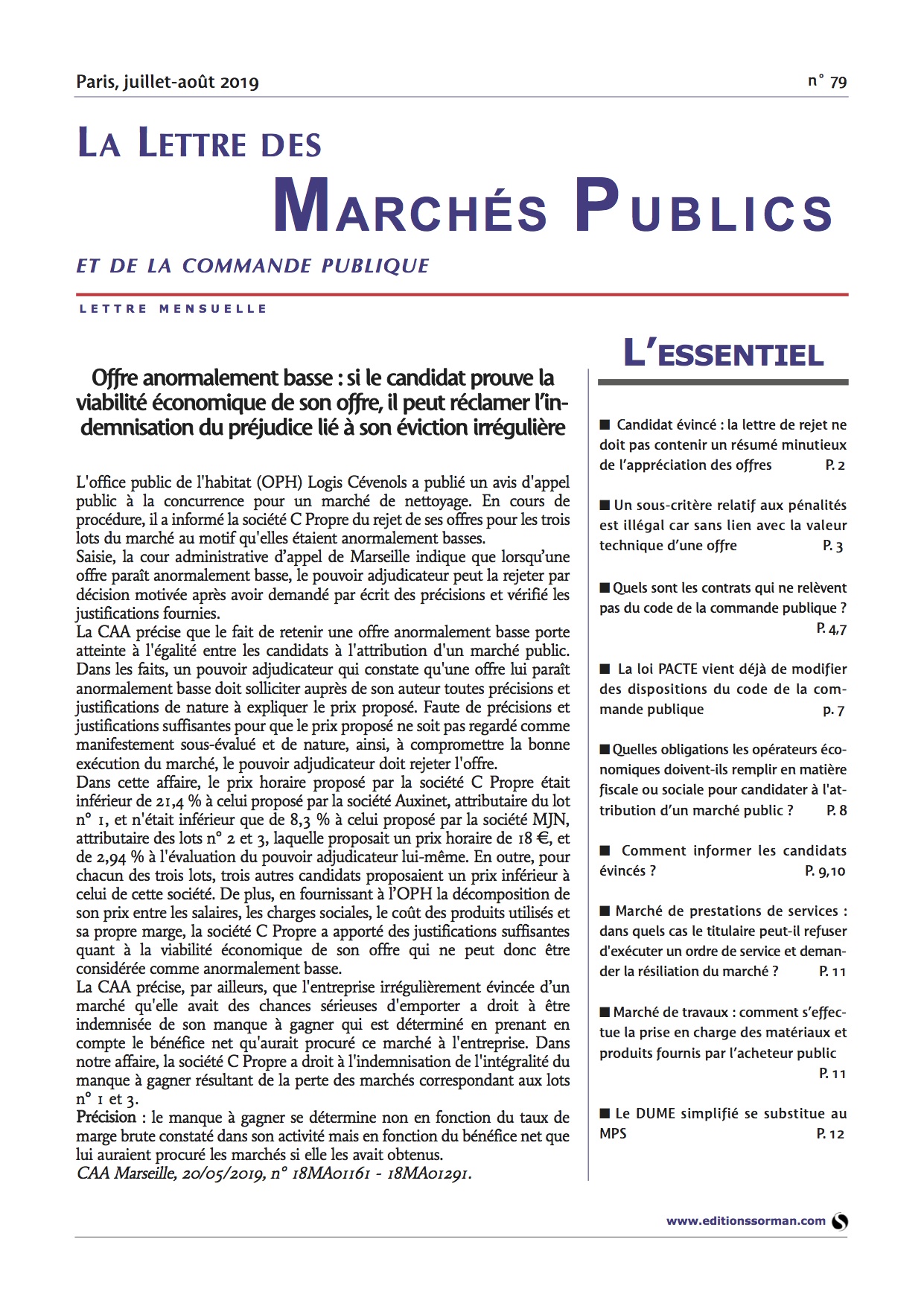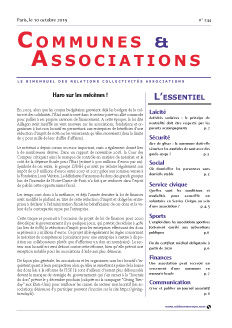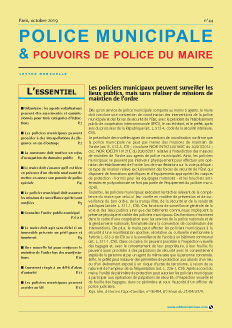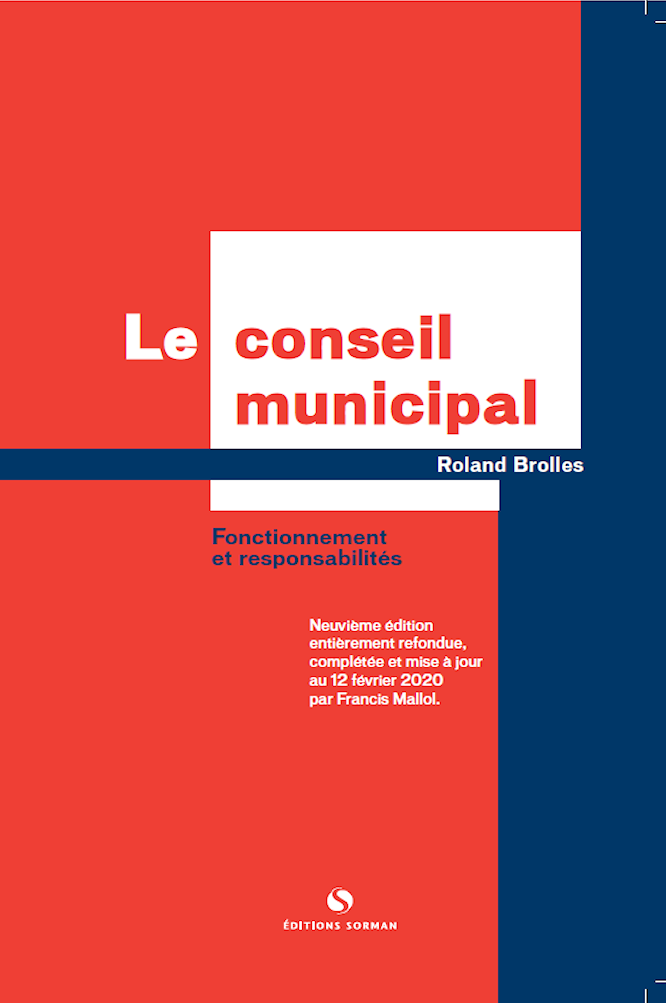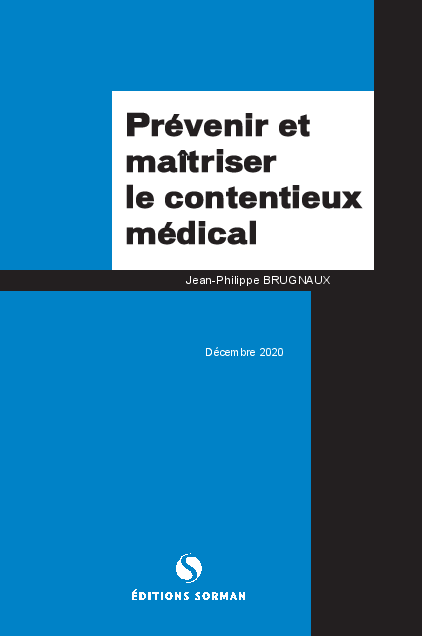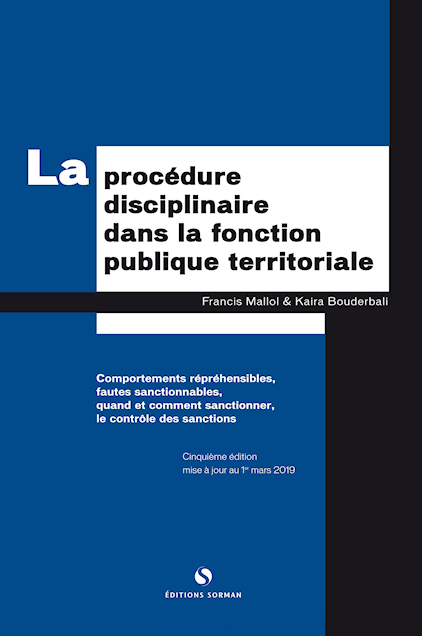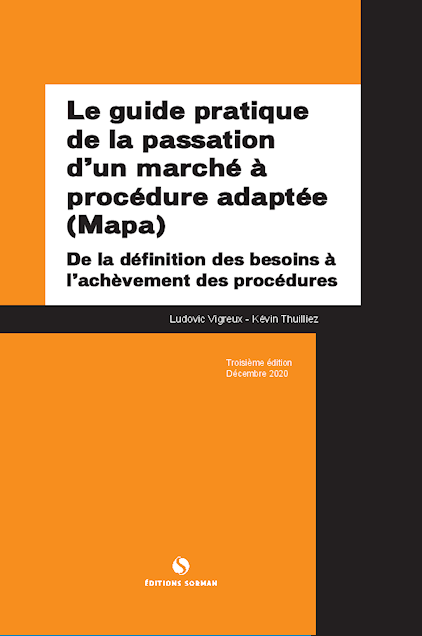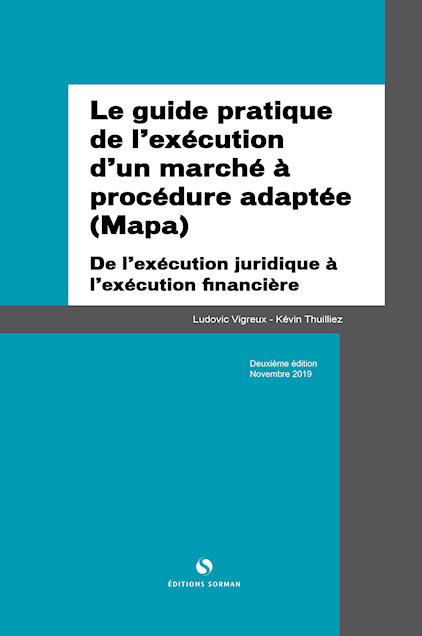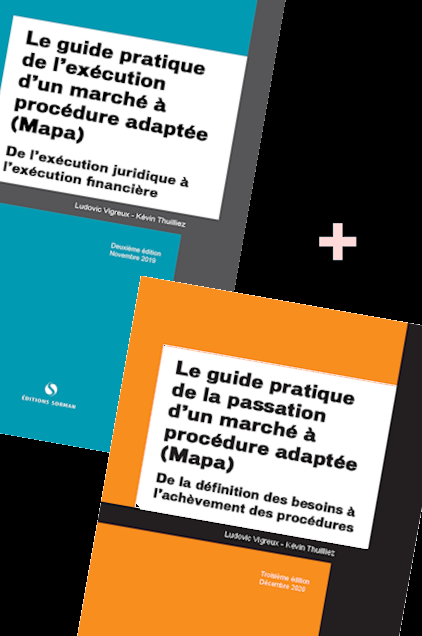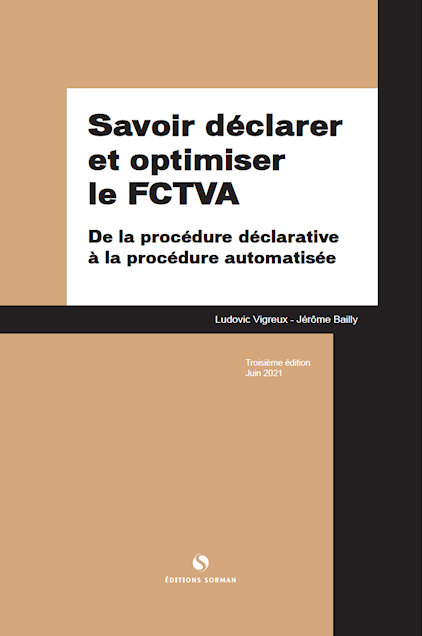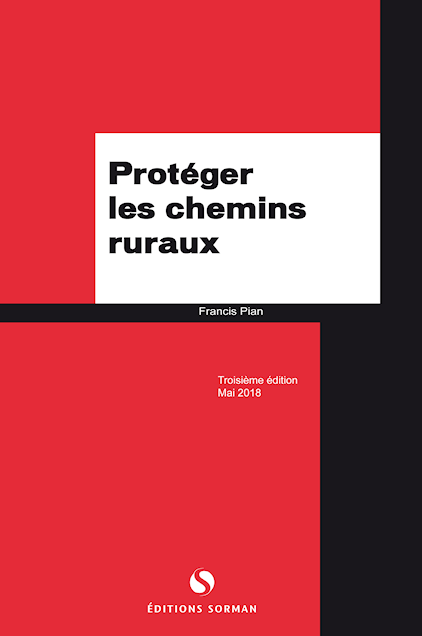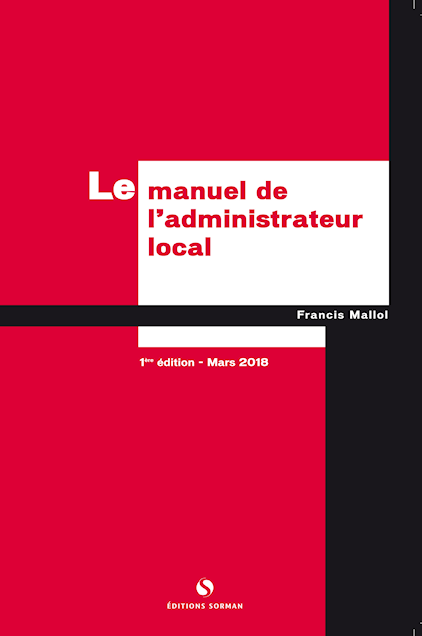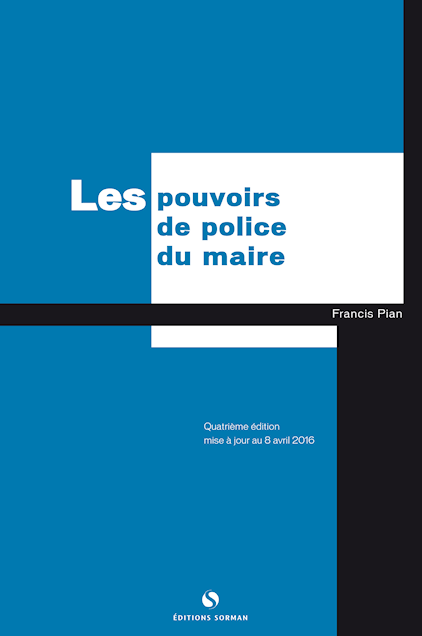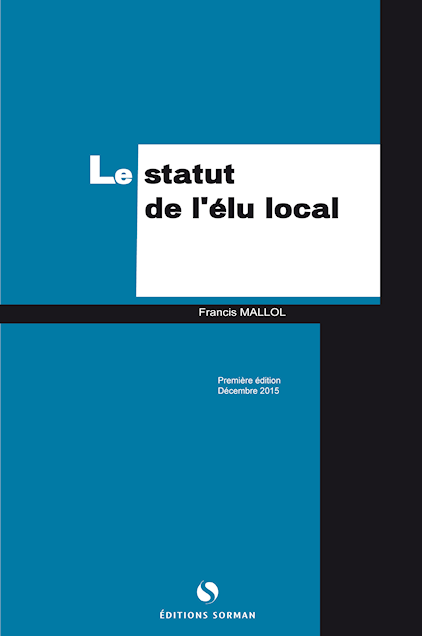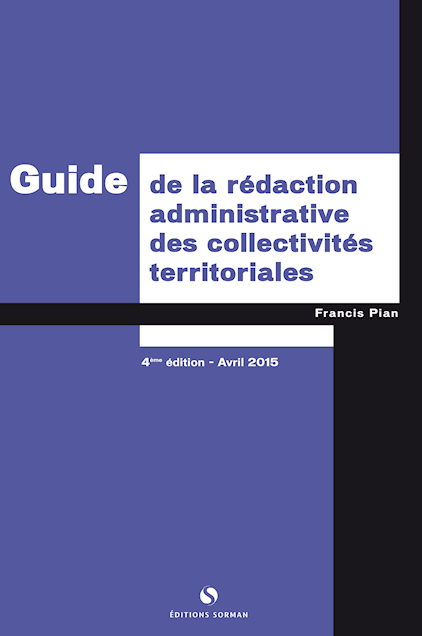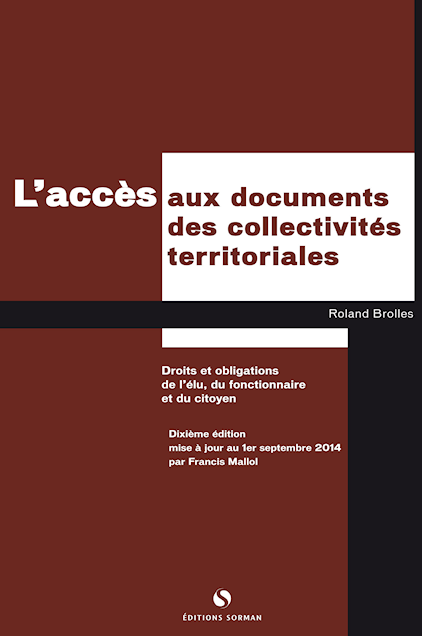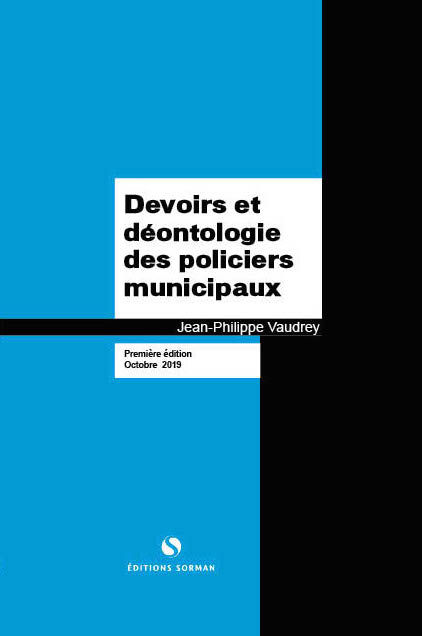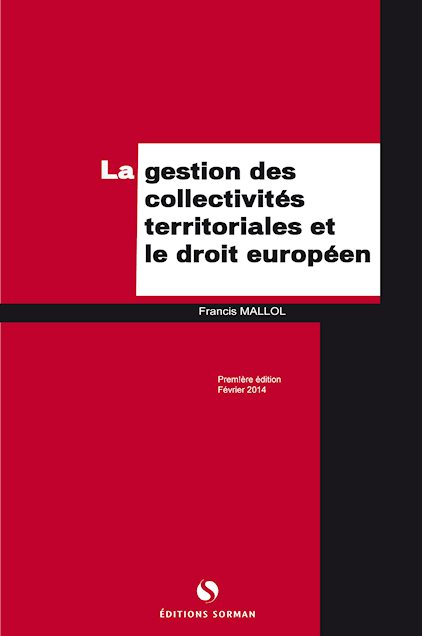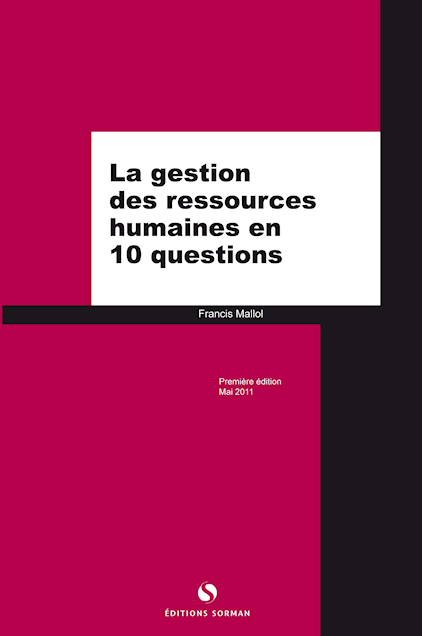La déploiement de la fibre doit encore être amélioré Abonnés
Il nous a semblé utile de faire le point avec Ariel Turpin, délégué général de l’AVICCA (Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel), dont le sénateur de l’Ain, Patrick Chaize (Les Républicains), vient d’être réélu président.
Entretien.
La Lettre du Maire : au printemps dernier, nous avons rencontré le sénateur Patrick Chaize qui nous a détaillé les trois zones numériques du territoire français : 106 communes classées en zone très dense à l’intérieur desquelles les quatre opérateurs (Orange, Free, Bouygues, SFR) sont censées, selon la réglementation, se livrer une forte concurrence qui aurait dû assurer le raccordement de tout le monde. La zone AMII (appel à manifestation d’intérêt d’investissement) dans laquelle Orange et SFR se sont engagés, sous peine de sanction financière, à déployer la fibre, et enfin les zones RIP (réseau d’initiative publique), correspondant aux parties du territoire dans lesquelles la carence de l’initiative privée est avérée, ce qui autorise les collectivités territoriales à bénéficier de subventions si elles interviennent, ce qu’elles font soit directement soit en déléguant cette mission à des entreprises privées. Peut-on dire que les problèmes de complétude FttH (« fibre optique jusqu’au domicile ») n’existent que dans ces zones peu peuplées ?
Ariel Turpin : non, le problème existe partout, même dans les 106 communes denses. A Paris, par exemple, 4 % du territoire ne sont pas couverts, cela semble peu, mais cela représente 65 000 foyers. Et à Nancy, 66 % de la ville seulement sont couverts.
La LDM : comment expliquer ces difficultés dans les zones denses ?
A.T : plusieurs explications peuvent être avancées. D’abord les secteurs classés, qui peuvent interdire l’implantation d’équipements de toute nature, y compris télécom. Ainsi, le cour Mirabeau et le centre historique d’Aix-en-Provence ne sont pas couverts car l’opérateur exigeait de pouvoir implanter sur le cour et dans les rues étroites nombre de grandes armoires, ce que le règlement d’urbanisme de la ville interdisait. L’opérateur n’a pas accepté les implantations de substitution proposées par la collectivité, probablement pour des raisons de coût. Les règles d’urbanisme peuvent, en effet, induire des délais et/ou des surcoûts et rendre plus difficile ou cher le raccordement.
Enfin, certains propriétaires d’immeubles collectifs ont pu renoncer à la fibre en raison des échos négatifs sur la difficulté du déploiement et plus encore des raccordements.
La LDM : justement, en juin dernier, Patrick Chaize nous expliquait les dégâts causés par le recours à la sous-traitance. Jean-Noël Barrot, ministre chargé du Numérique, vous a-t-il donné des assurances d’amélioration sur ce point ?
A.T : non, pourtant une loi a déjà été votée à l’unanimité par le Sénat, et l’AVICCA se bat pour convaincre le pouvoir d’en finir avec cette spécificité française. La France a fait le choix de confier le déploiement aux opérateurs d’infrastructures, avec cependant une obligation : confier le raccordement aux opérateurs commerciaux (Bouyges Télécom, Free, Orange et SFR) si ces opérateurs en font la demande.
En 2015, lorsque ce choix a été fait, il pouvait se comprendre. Les opérateurs ne se font pas forcément confiance et, pour éviter qu’ils s’accusent mutuellement de ne pas avoir réalisé correctement le travail de raccordement, l’Arcep les a autorisés à effectuer eux-mêmes le raccordement de leurs clients. Or, l’Etat et les collectivités versent une subvention pour chaque raccordement (300 euros environ) à l’opérateur commercial, à charge pour lui de trouver un sous-traitant qui effectuera le travail. Souvent, le premier sous-traitant contacté est trop mal payé pour avoir un intérêt à réaliser lui-même le raccordement. De ce fait, il sous-traite, notamment les raccordements, qui exigent par exemple d’utiliser une nacelle, ou pour toute autre contrainte technique.
En fin de chaîne, c’est un sous-traitant, souvent avec le statut d’autoentrepreneur, qui prend tous les risques, ne respecte aucune règle de sécurité et décharge de toute responsabilité l’opérateur. Il est mal payé car non seulement les travaux sont insuffisamment rémunérés mais, de surcroît, à chaque étape de la délégation, une commission est prise. Et si un accident survient parce que l’auto-entrepreneur n’a respecté aucune règle de sécurité, l’accident ne sera pas déclaré.
Ce système ne peut plus durer, d’autant qu’aucun opérateur n’a intérêt à être vertueux. Si l’un d’entre eux paye bien son sous-traitant et lui laisse le temps de travailler, il installera moins de clients en une journée, pour un coût beaucoup plus élevé à l’installation. Cela n’empêchera pas les autres opérateurs de recourir à des sous-traitants mal payés qui débrancheront l’installation bien montée pour la remplacer par la leur à la-vite. L’AVICCA milite donc pour que l’on sorte de ce cercle vicieux.
La LDM : lors du colloque organisé récemment par l’AVICCA, le ministre Jean-Noël Barrot a annoncé que l’Etat ne demanderait pas de sanction contre Orange en raison du retard de déploiement dans la zone AMII, pour la seconde échéance de 2022, et qu’il préférait parvenir à un accord. Cela vous satisfait-il ?
A.T : si on se fie aux seuls propos du ministre, nous sommes pleinement satisfaits mais nous ne connaissons pas les termes de l’accord. Il faudra donc voir sur pièce. Le ministre annonce par exemple le droit à un raccordement à la demande de chaque habitant de la zone AMII. Le particulier qui demandera son raccordement devra voir sa demande honorée sous six mois. Est-ce techniquement possible ? Le non-respect est-il juridiquement et opérationnellement sanctionnable ? Nous verrons. Car si Orange ne satisfait pas certaines demandes, le particulier devra saisir l’ARCEP, et cela paraît difficilement faisable.
La LDM : lors de votre colloque, le problème des coûts d’exploitation du réseau dans les zones RIP a également été évoqué. Quel est le problème ?
A.T : il est simple. Lors du déploiement du réseau cuivre, une péréquation existait. Qu’il s’agisse d’une installation à Paris ou en Lozère, le client payait la même somme et l’opérateur percevait la même rémunération : le coût d’installation était fixée au même prix dans une ville dense et dans une région retirée, alors que le coût était moindre dans la première ; ce surcoût finançait le coût supplémentaire en Lozère par rapport au prix payé par l’usager. Avec la fibre optique, l’usager paye bien la même somme sur tous les points du territoire. Mais la péréquation, elle, a disparu. Résultat : les collectivités territoriales qui sont en charge du réseau dans les zones RIP ont des coûts plus élevés sans péréquation ; le réseau est souvent aérien, plus sensible aux incidents comme les intempéries. Les collectivités n’ont pas les moyens de financer le passage au réseau souterrain sans aide. C’est un autre combat pour l’AVICCA.
Michel Degoffe le 28 novembre 2023 - n°2296 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline