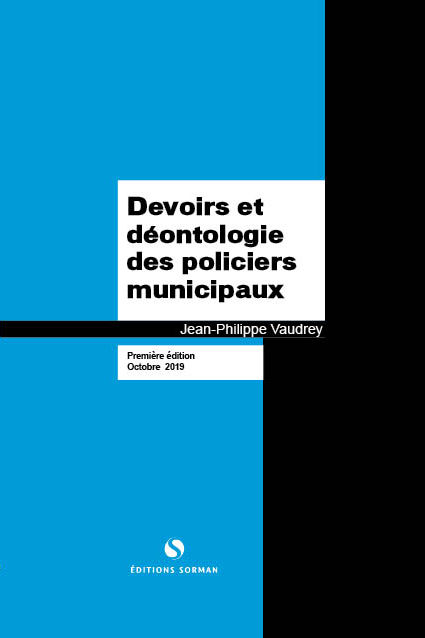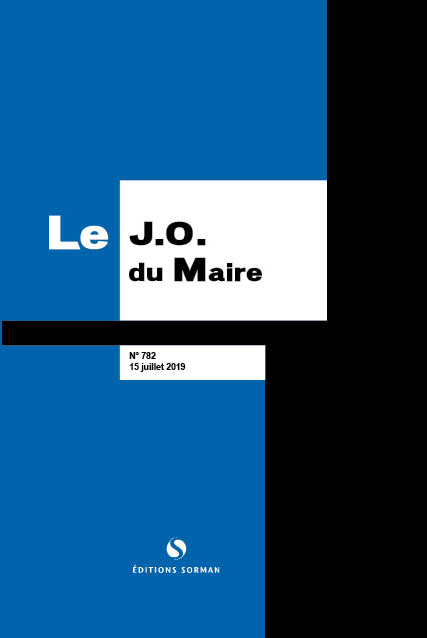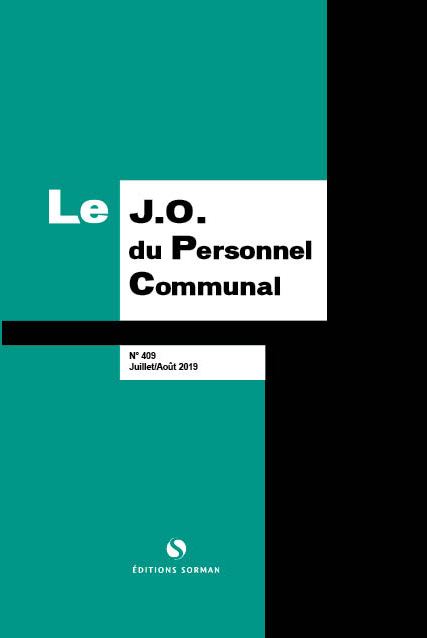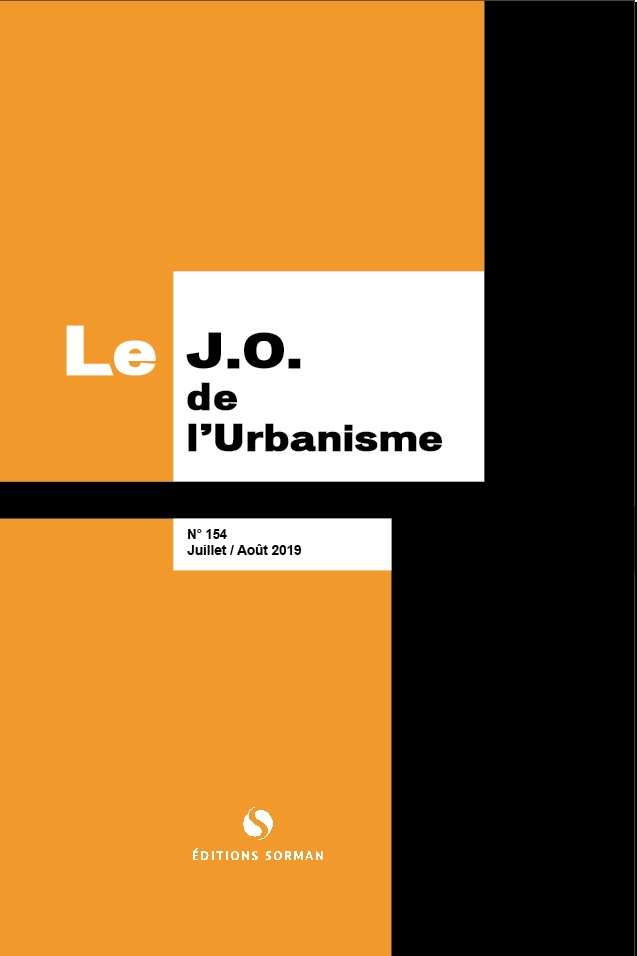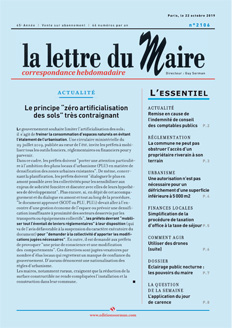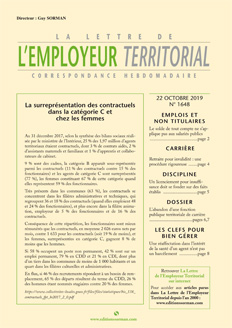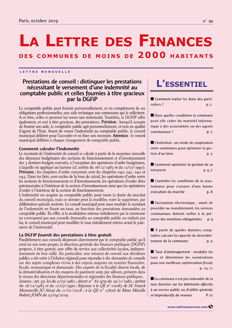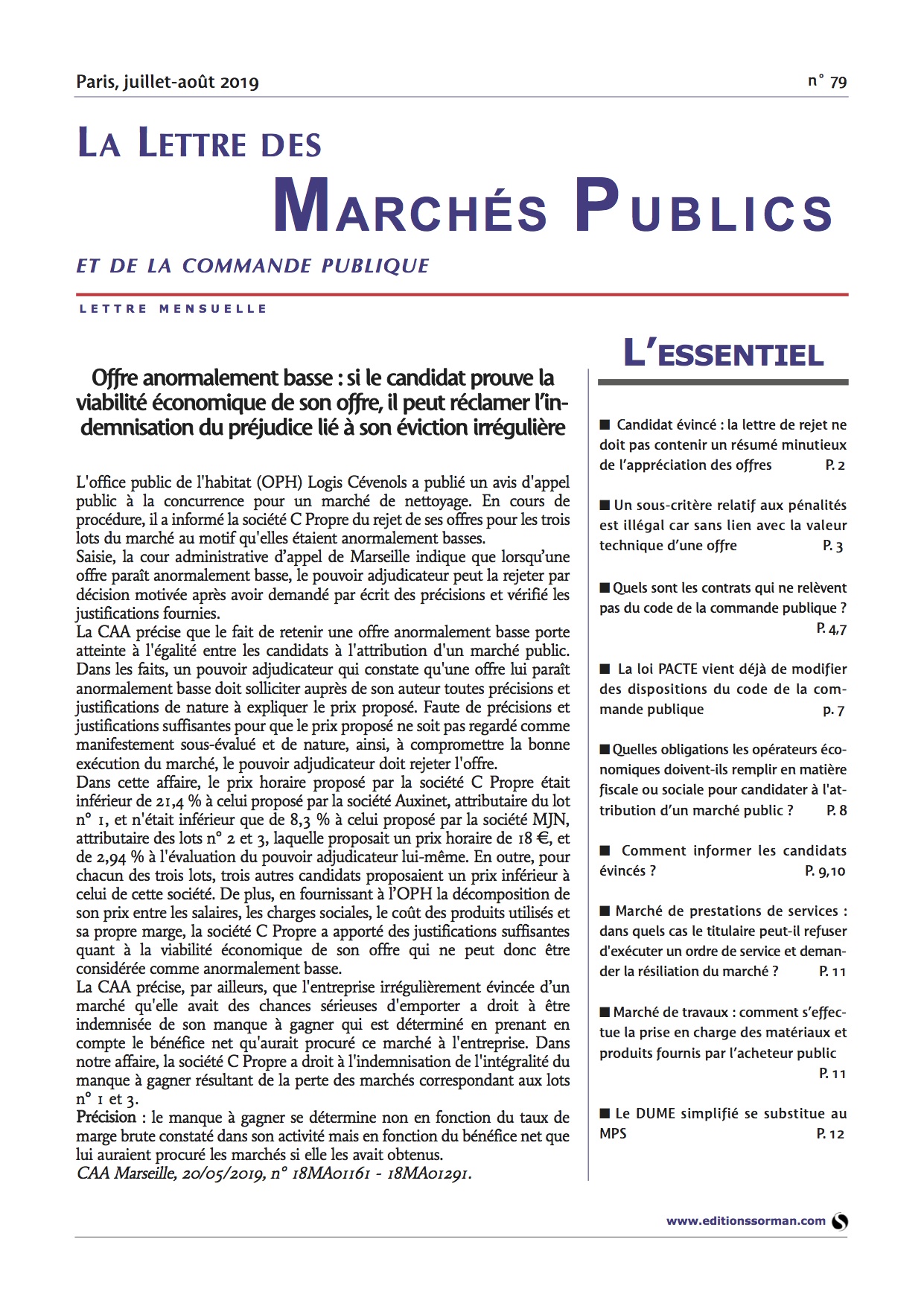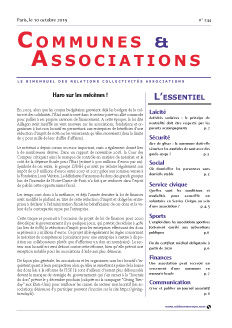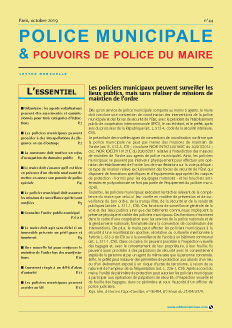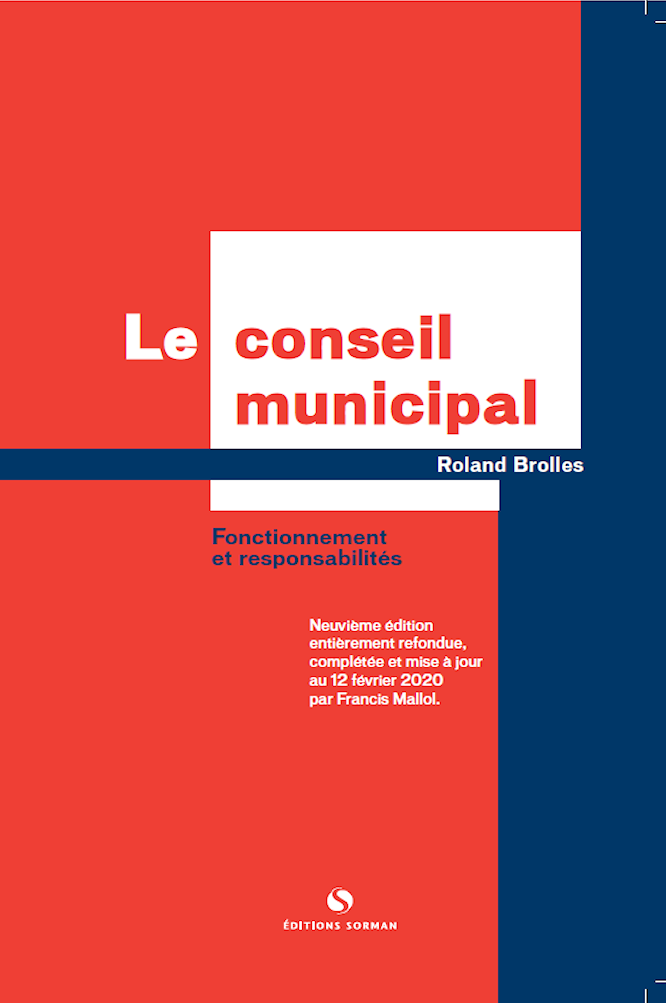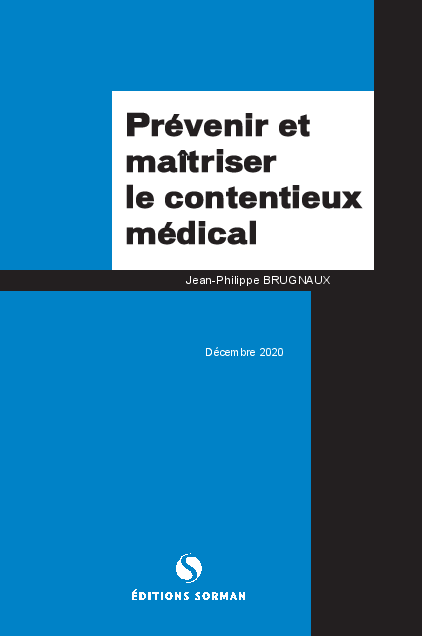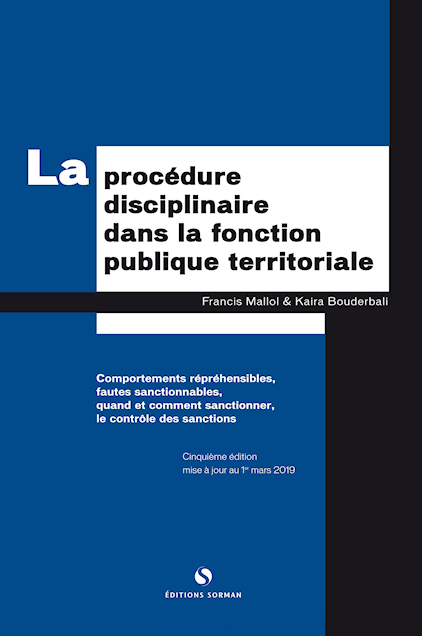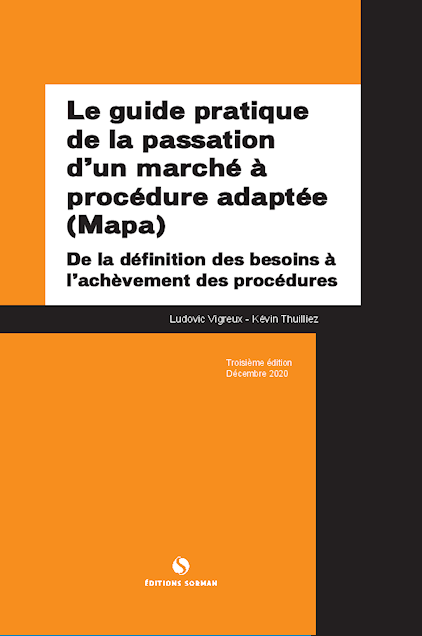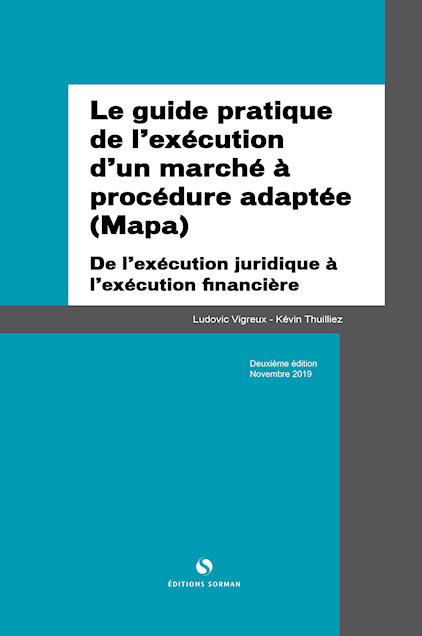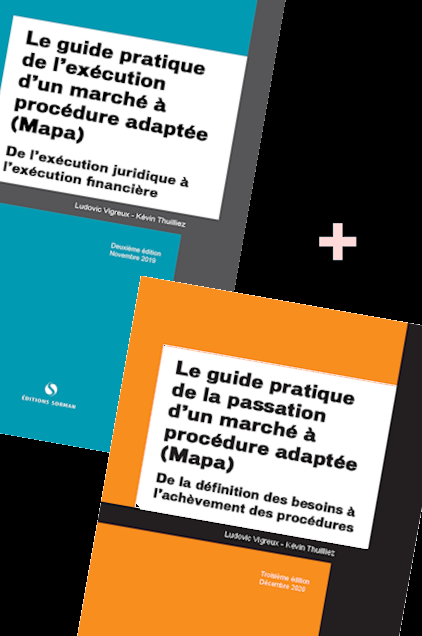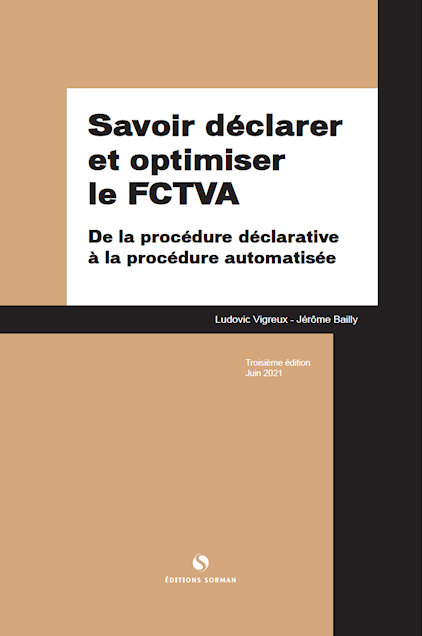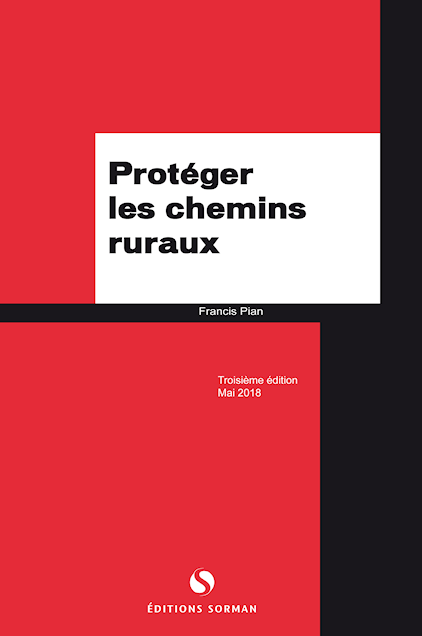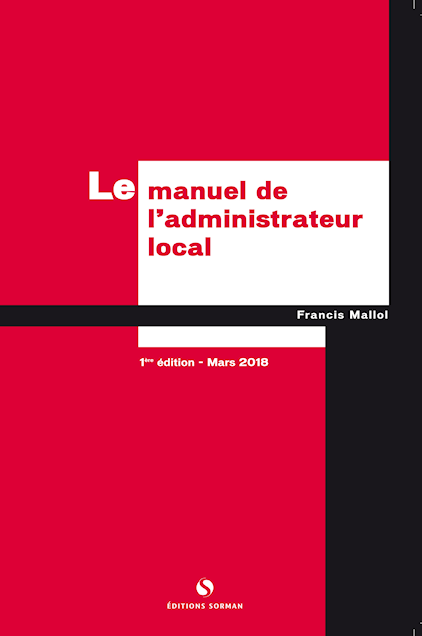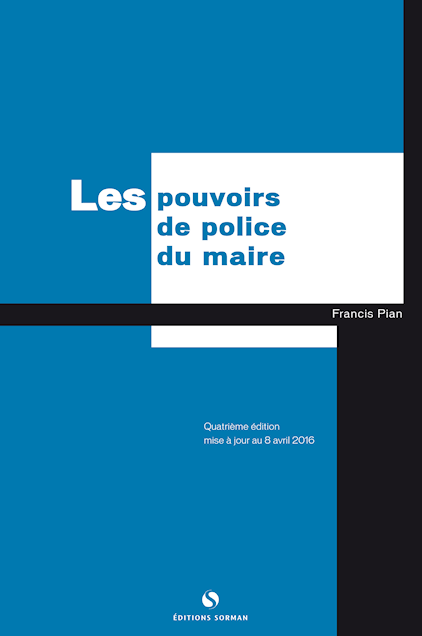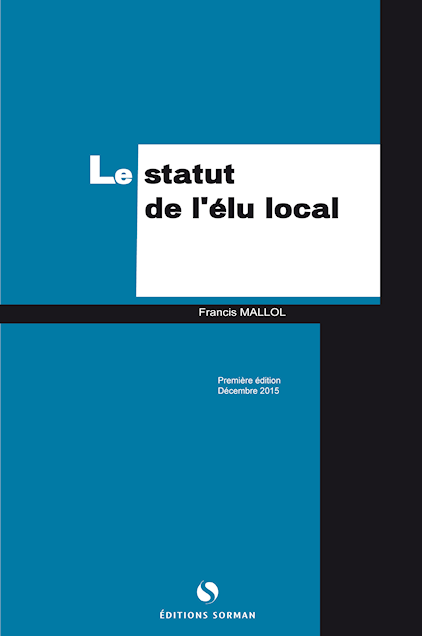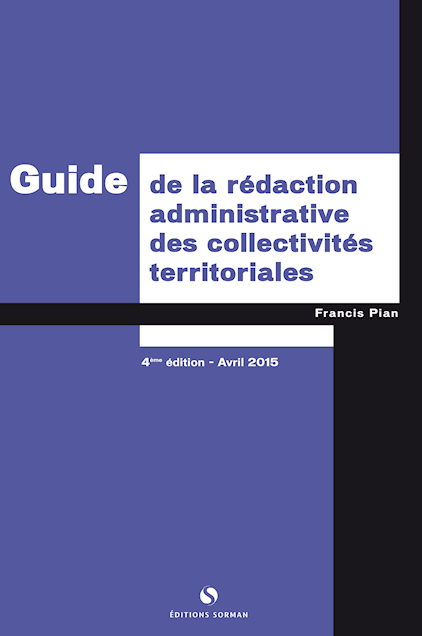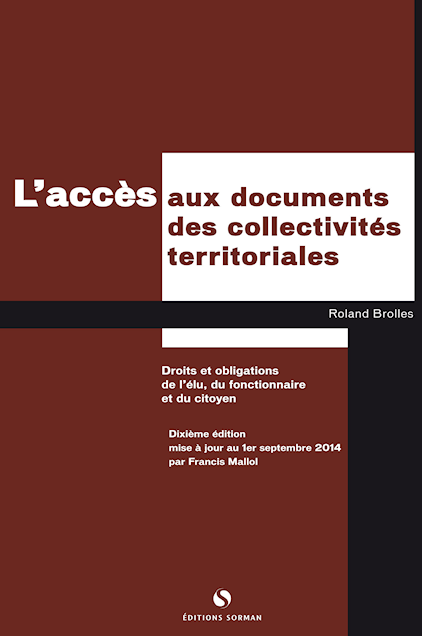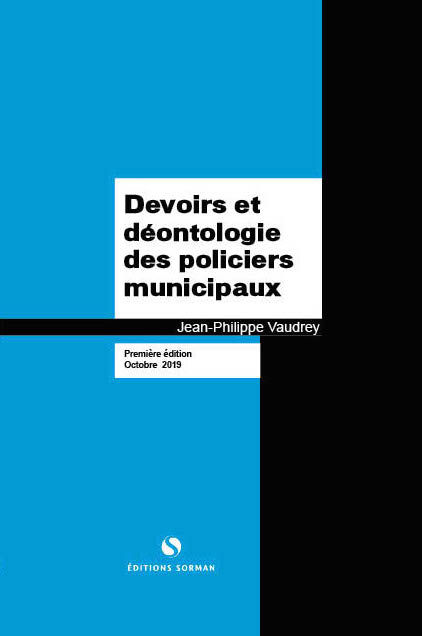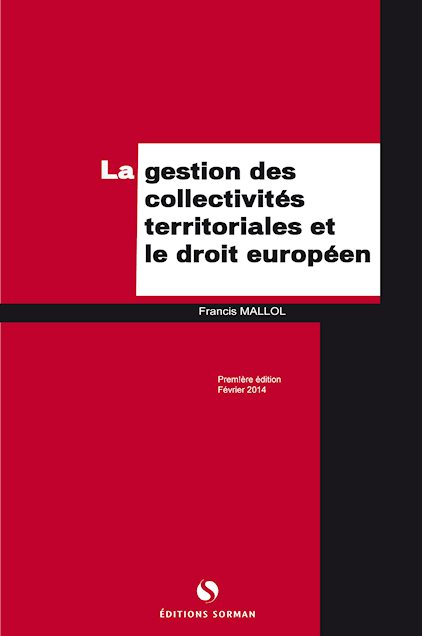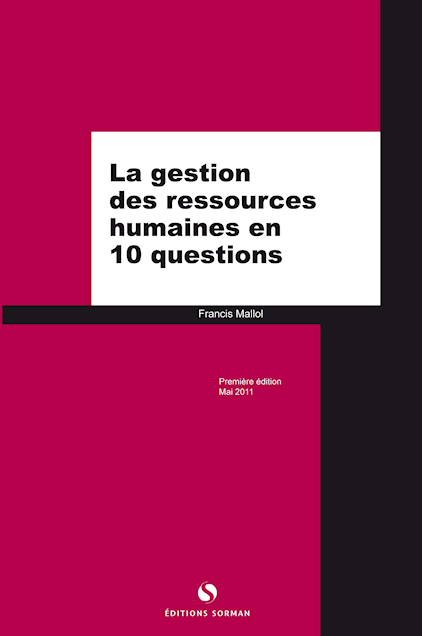Faut-il s’équiper en vidéoprotection ? Abonnés
De la vidéosurveillance à la vidéoprotection
Si de plus en plus de collectivités l’utilisent, c’est parce que la sécurité est l’une des premières préoccupations des élus locaux. L’insécurité est un thème qui mobilise les administrés.
Ainsi, la vidéosurveillance des années 2000 a évolué vers la vidéoprotection, dont l’objet est de mieux prévenir et rassurer les citoyens. Le succès toujours grandissant de la vidéoprotection est également lié à son extension à d’autres usages, notamment la vidéoverbalisation des infractions routières et les dépôts de déchets sauvages. Les petites communes, périphériques des grandes agglomérations, s’équipent également de peur que la délinquance se déplace vers leur territoire.
Le coût du matériel a baissé mais les coûts de fonctionnement peuvent être très importants
En 2013, un rapport du Sénat déplorait le coût élevé des systèmes de surveillance. Mais, depuis, la technologie a fait des progrès et on observe une baisse significative des coûts des caméras. Le coût unitaire est passé, en moyenne, de 10 000 à 15 000, à 3 000 euros. Et si les subventions étaient plus importantes il y a quelques années, l’Etat, avec le Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), continue d’allouer 15 millions d’euros d’aides en 2022. D’autres aides de l’Etat en faveur des collectivités peuvent également être mobilisées, notamment la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation politique de la ville (DPV). Ces financements pouvant être cumulés avec les fonds de concours des EPCI.
Si le coût du matériel a diminué, il convient toutefois d’être vigilant quant aux coûts d’installation et de maintenance. Il faudra intégrer au coût du matériel les frais de raccordements électriques, qui peuvent générer des travaux de réseaux importants, et l’implantation de mâts ou d’antennes relais pour le transfert d’images. A noter également que l’équipement ne se résume pas aux caméras, il convient d’y ajouter les frais d’acquisition de logiciels, d’ordinateurs, et l’aménagement d’un centre de supervision urbaine (CSU) qui doit être climatisé.
Deux modes de gestion, active et passive
Tandis que les grandes villes mettent le plus souvent en place des caméras reliées à des CSU avec des agents visionnant les images en direct, les plus petites communes adoptent des caméras dites « passives », qui filment en continu la voie publique et stockent les images sur des disques durs pendant une période limitée.
Les coûts de fonctionnement sont très variables selon le mode de gestion. Visionner 7 jours sur 7 et 24h sur 24h entraîne un coût important en masse salariale, l’avantage d’un tel système reposant essentiellement sur une protection en temps réel.
En revanche, le seul enregistrement des images ne génère aucune charge de fonctionnement supplémentaire. Dans ce système, la protection peut sembler moins efficace. Cependant, l’utilisation du système de protection « passive » n’interdit pas un visionnage des images en direct, lorsque le contexte l’exige. Par exemple, lors d’évènements particuliers qui rassemblent un public nombreux : concerts, fêtes, brocantes, etc., ou à l’occasion de signalements récurrents de tapages nocturnes ou de rodéos sur la voie publique. Par ailleurs, on peut se doter de logiciels qui recherchent automatiquement les images enregistrées sur la base de critères prédéfinis (plaque d’immatriculation, voiture bleue, moto… ). Ils permettent d’économiser la charge de personnel dédié au visionnage.
La Ville de Wavrin (Nord, 7 800 habitants) a commencé par organiser un référendum, pour soumettre son projet de vidéosurveillance aux administrés et obtenir leur soutien. Elle s’est ensuite attribuée les services d’une assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée pour définir les besoins, chiffrer le projet, rédiger le dossier de consultation, analyser les offres, contrôler l'exécution et la réception des travaux et solliciter la subvention FIPD et l'autorisation préfectorale. Coût de l’étude : 11 000 € TTC. Puis la commune a publié un avis d’appel public à la concurrence en vue de l’attribution d’un marché de fourniture et service. Le dispositif complet de vidéoprotection prévoyait l’installation et la mise en œuvre de 28 caméras vidéo dont 27 fixes et 1 mobile haute résolution, des équipements de transmission avec raccordement au réseau d’interconnexion et centralisation des données, la mise en service d’un CSU. Le projet prévoyait également la réalisation des travaux de génie civil pour relier les équipements et le CSU, la fourniture, le tirage et le raccordement des câbles cuivre et optiques, les alimentations et raccordements électriques et la formation des futurs opérateurs, pour un coût total de déploiement et de mise en fonctionnement de 240 000 € TTC.
Après une année de fonctionnement, la commune a constaté que le dispositif avait un effet dissuasif : la délinquance a baissé, le taux de résolution des enquêtes judiciaires s’est amélioré, atteignant une moyenne de 43 %, soit 3 fois plus d’élucidation des cambriolages que dans les communes voisines non équipées, + 250 % d’élucidation pour les vols de véhicules et + 225 % pour les vols à la roulotte.
Marie Boulet
Paul Durand le 07 juin 2022 - n°2229 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline