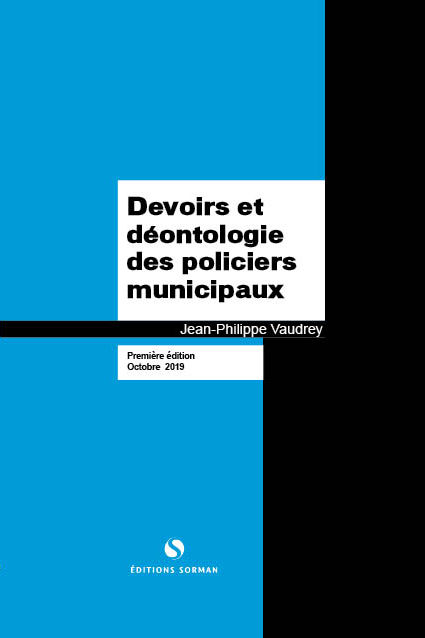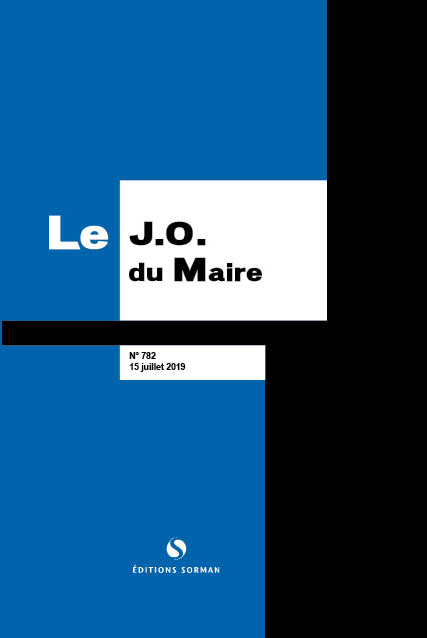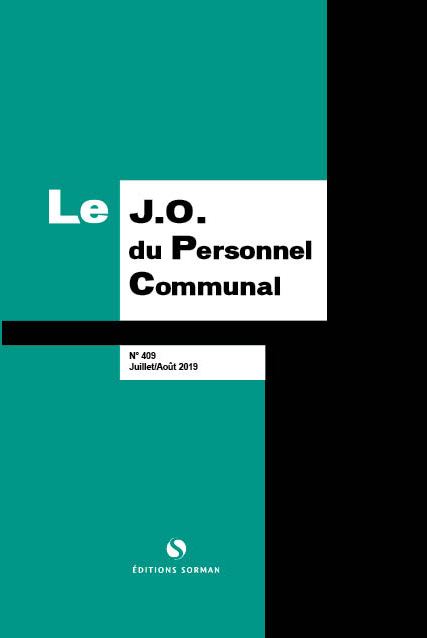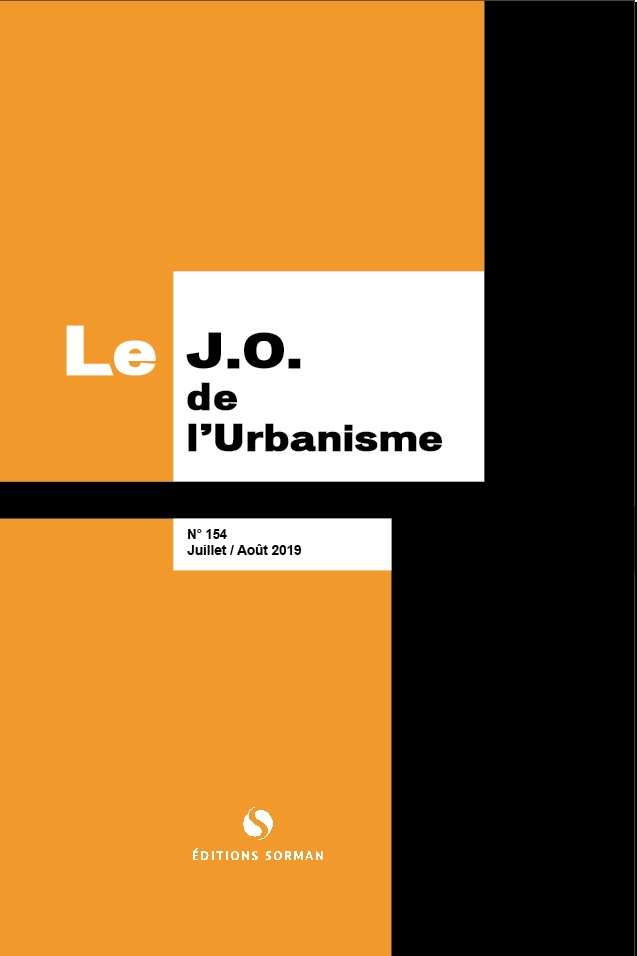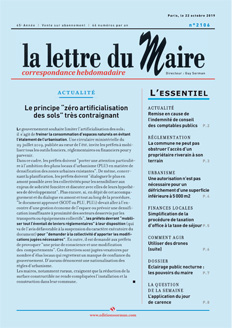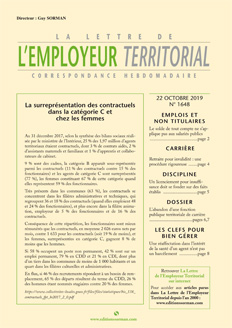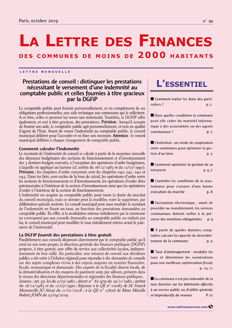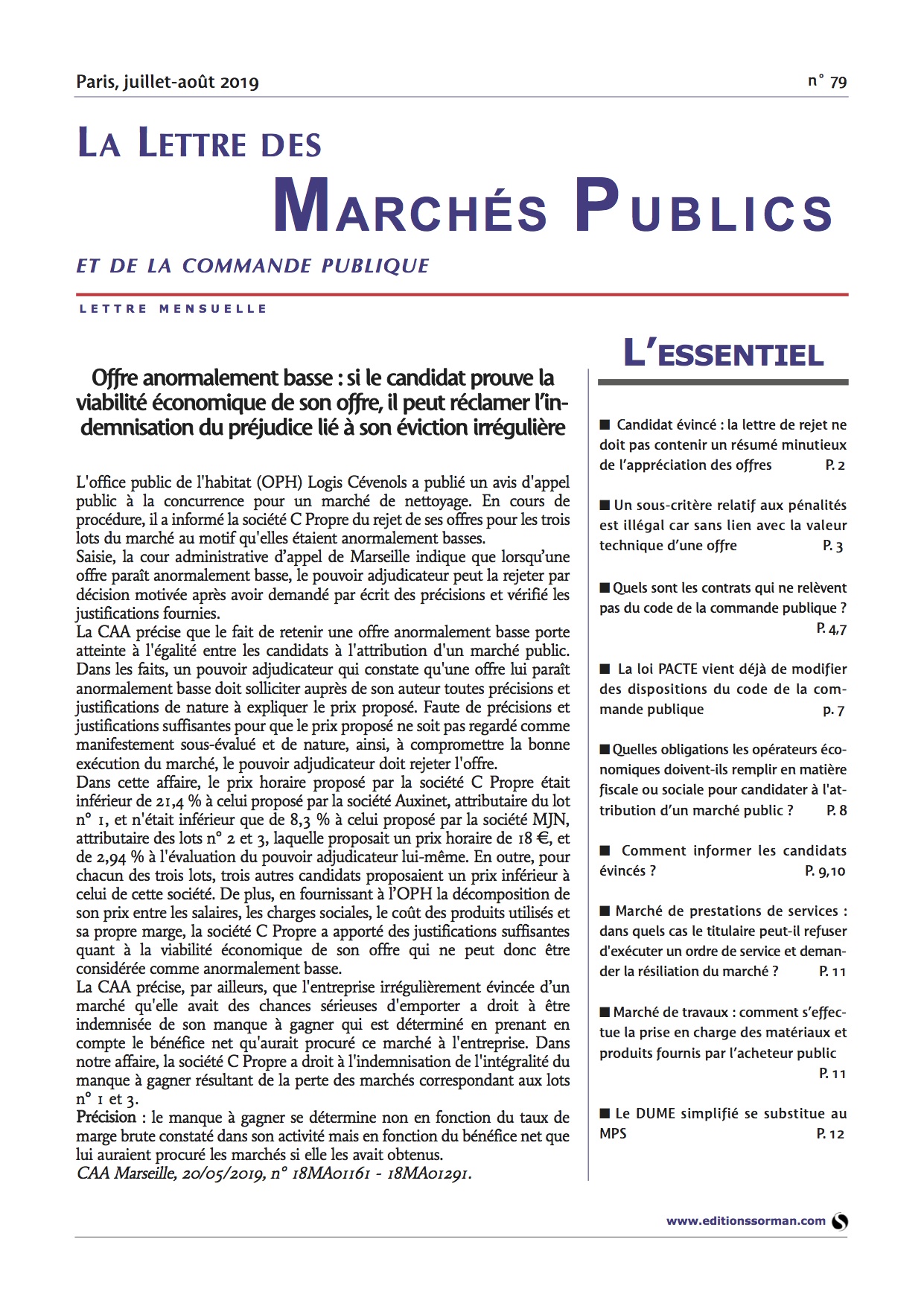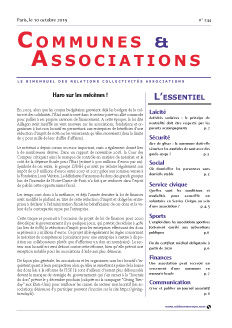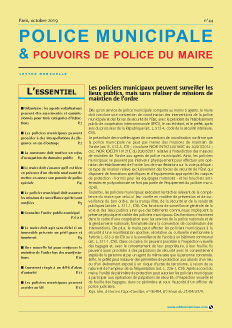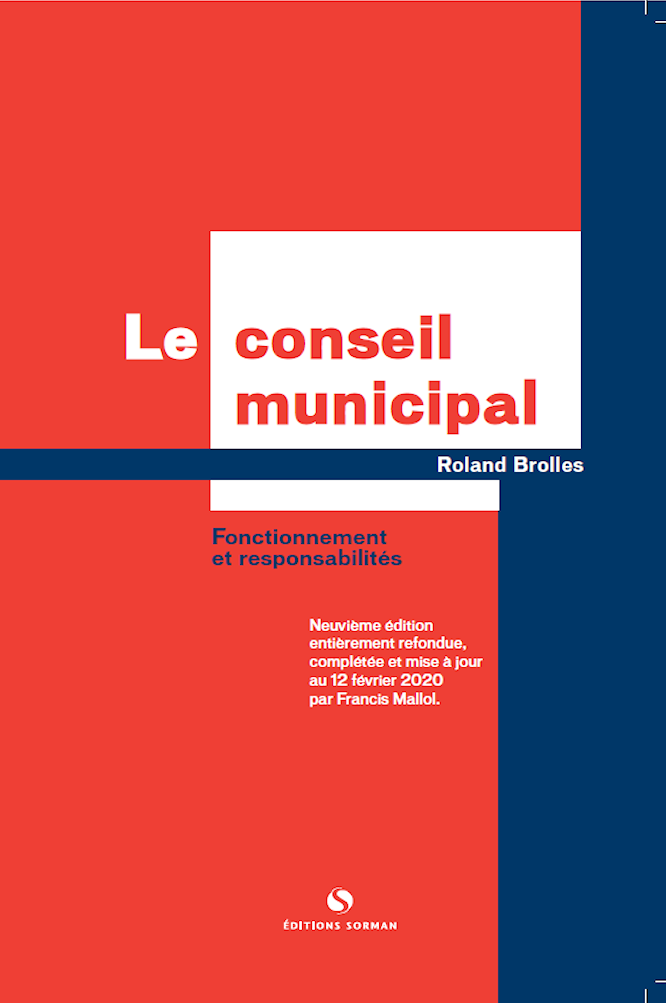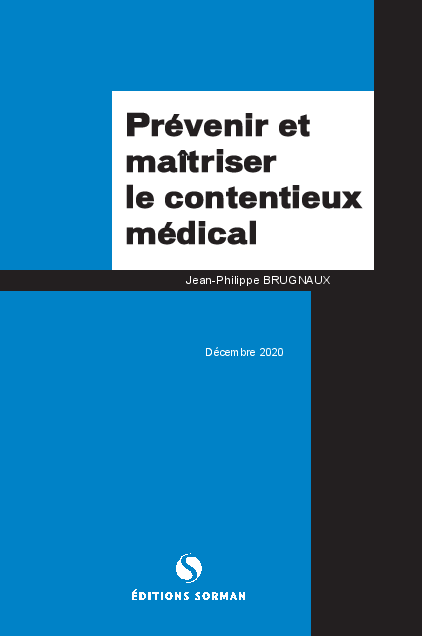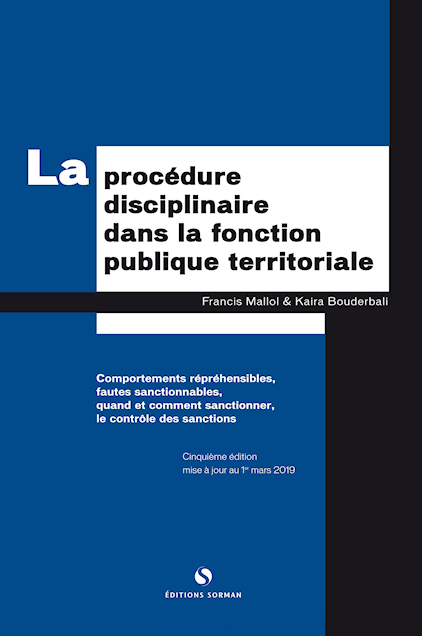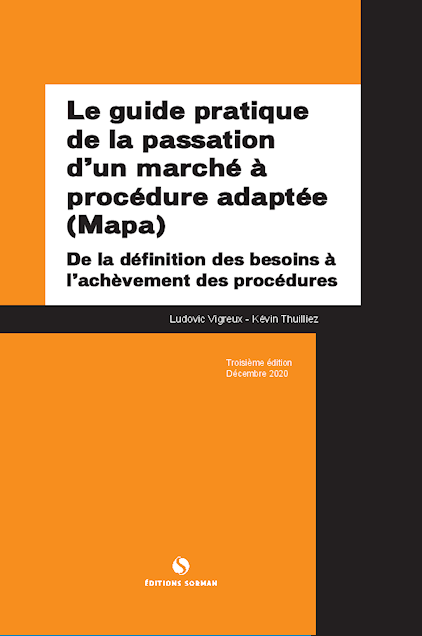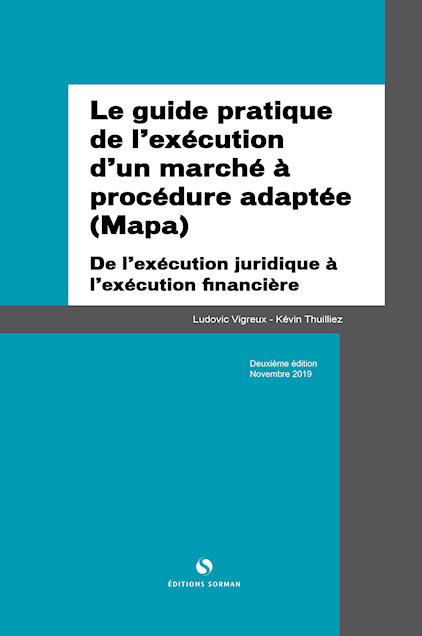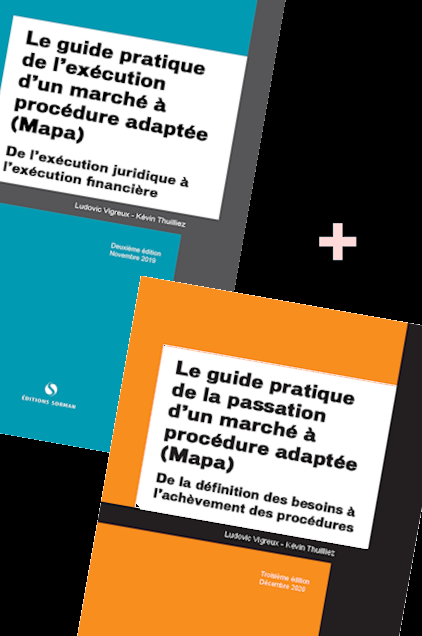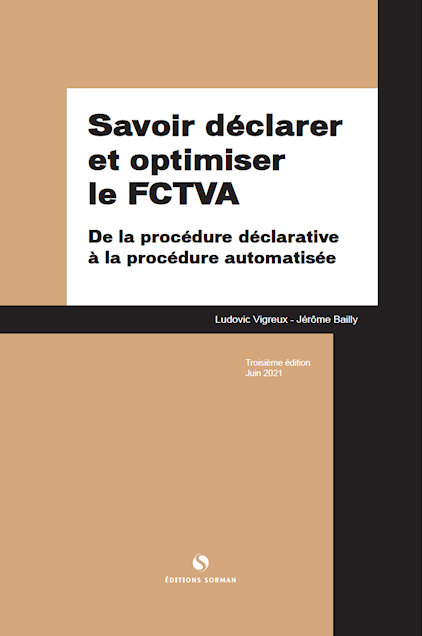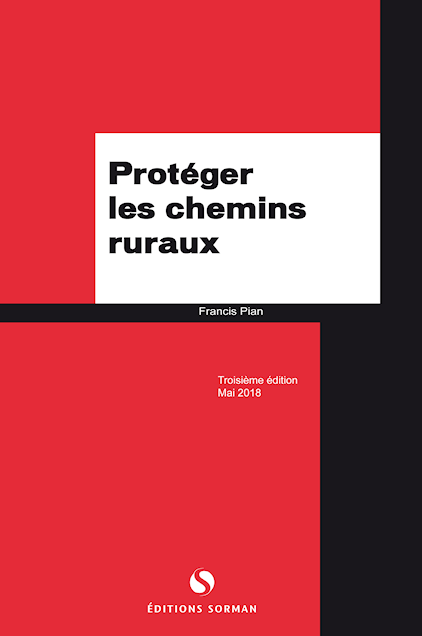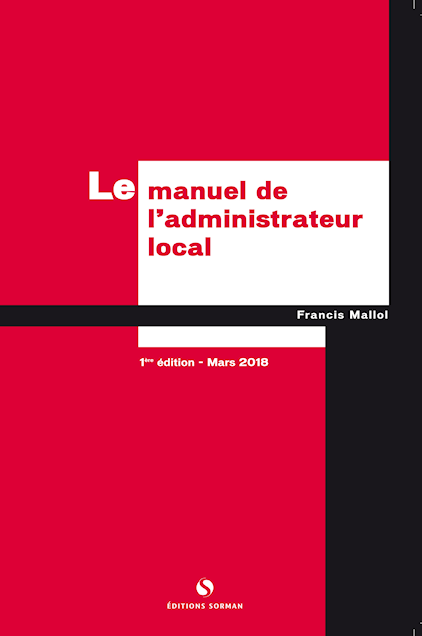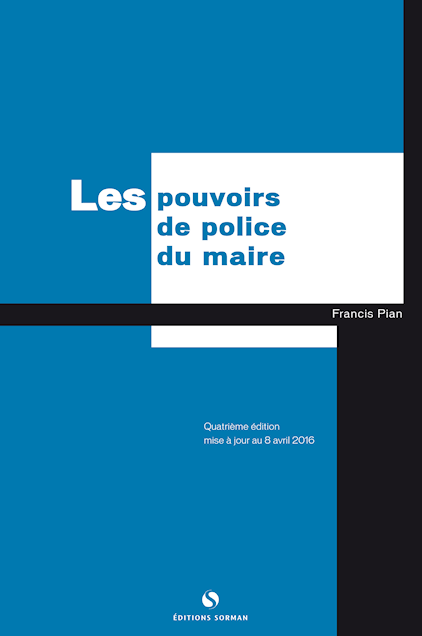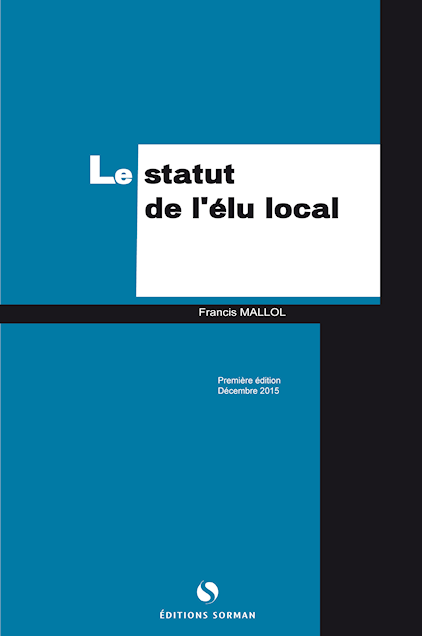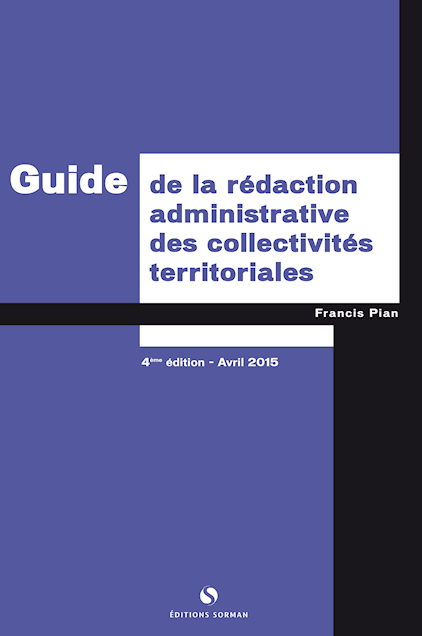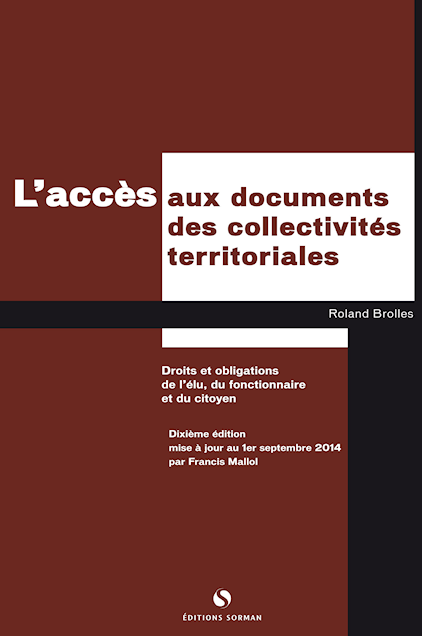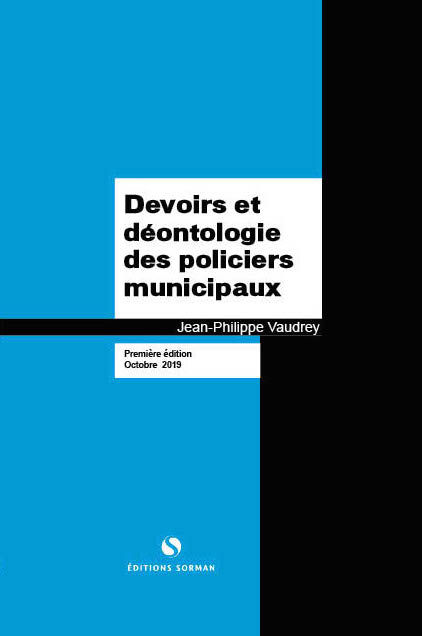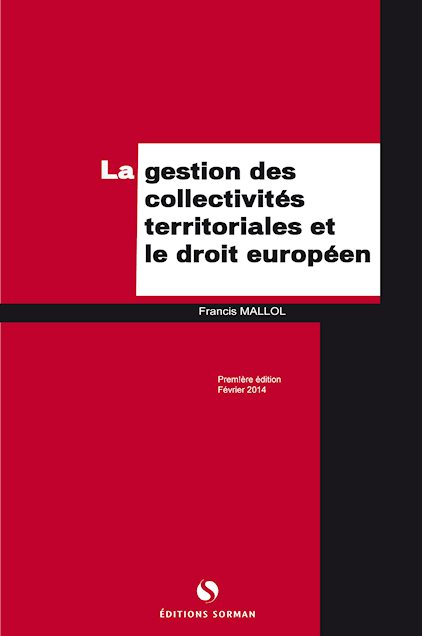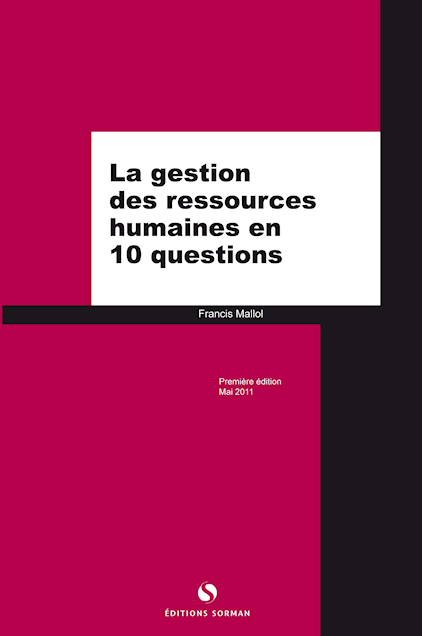Développer son réseau de bornes de recharge électriques Abonnés
Entretien.
La Lettre du Maire : où en est le déploiement des bornes électriques ?
Audrey Maurel : dans ce domaine, la situation ressemble à celle qui prévaut dans le déploiement de la fibre optique. Il y a des zones dans lesquelles les opérateurs se déploient sans difficultés car ils savent qu’il y a un besoin à satisfaire, et des zones dans lesquelles, sans initiative publique, il n’y aura pas de déploiement.
La LDM : comment les collectivités procèdent-elles ?
A.M : en général, elles lancent des appels à manifestation d’intérêt (AMI). Une telle procédure est hors du champ de la commande publique. Il ne s’agit pas d’un marché public ou d’une concession. La collectivité délivrera les autorisations d’occupation du domaine public (AOT) nécessaires pour implanter les bornes. Dans ce modèle, les collectivités publiques ont peu de marge de contrôle sur les tarifs ou les emplacements. Elles ont intérêt, sans doute, à prévoir des AOT d’une durée assez longue - 15 ans par exemple – afin de lisser l’amortissement pour l’opérateur.
La LDM :dans les zones économiquement peu attrayantes, les collectivités doivent-elles aider les opérateurs pour les faire venir ?
A.M : oui. Le plus souvent, elles confient cette mission aux syndicats départementaux d’énergie, interlocuteur nécessaire car il y a des impératifs de raccordement aux réseaux. En Occitanie, par exemple, 10 syndicats d’énergie et 2 métropoles se sont associés pour créer le réseau de bornes de recharge pour véhicule électrique Révéo. Révéo Occitanie comptabilise plus de 1 200 infrastructures de recharge mais s’ouvre également aux autres réseaux nationaux. Dans le département de l’Aveyron, c’est le SIEDA (Syndicat Départemental d’Energies de l’Aveyron) qui a la charge de développer ces bornes accessibles au public.
La LDM : pour favoriser le développement des bornes, quelles sont les aides que la collectivité peut apporter ?
A.M : elle peut, par exemple, réduire le montant de la redevance domaniale. Toute occupation privative du domaine public doit donner lieu à redevance. C’est une exigence du code général de la propriété des personnes publiques. Mais la commune peut définir une part fixe faible et instituer une part variable plus importante, calculée sur le chiffre d’affaires.
La LDM : l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) présente-t-il un risque de requalification de contrat de commande publique ?
A.M : oui, si pour attirer les opérateurs, la collectivité publique verse une subvention pour l’investissement et pour le fonctionnement en contrepartie d’une prestation qu’elle définit, le risque de requalification en marché public ou concession existe.
La LDM : la solution peut-elle passer par des contrats mixtes ? Pouvez-vous nous les présenter ?
A.M : les collectivités publiques ont l’obligation d’acheter des véhicules électriques lorsqu’elles renouvellent leur parc automobile. La collectivité peut donc conclure un contrat relatif au développement de recharges pour alimenter ses véhicules, prestation en principe viable économiquement, couplée au déploiement de bornes sur le domaine public dont la rentabilité est aléatoire dans certains secteurs. Par exemple, dans l’Aveyron, le déploiement des bornes est rentable à Rodez. Il l’est moins dans les secteurs plus retirés du département. En couplant les deux prestations dans le même contrat, on peut trouver un modèle économique viable.
La LDM : quand la collectivité lance un AMI, à combien de réponses peut-elle s’attendre ?
A.M : cela dépend des régions. Entre 2 et 8, je dirais. Si, dans le territoire concerné, le tourisme est important à certaines périodes de l’année, il est plus facile de susciter l’intérêt.
A noter : des efforts restent à accomplir : dans un avis de l’an dernier, l’Autorité de la concurrence indiquait que 15 % seulement de la population considéraient que le réseau de bornes de recharge était suffisant. L’EPCI à fiscalité propre peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public (SDIRVE) pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables (art. L. 2224-37 du CGCT). Dans son avis, l’Autorité recommande que cela devienne une obligation.
Michel Degoffe le 15 avril 2025 - n°2359 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline