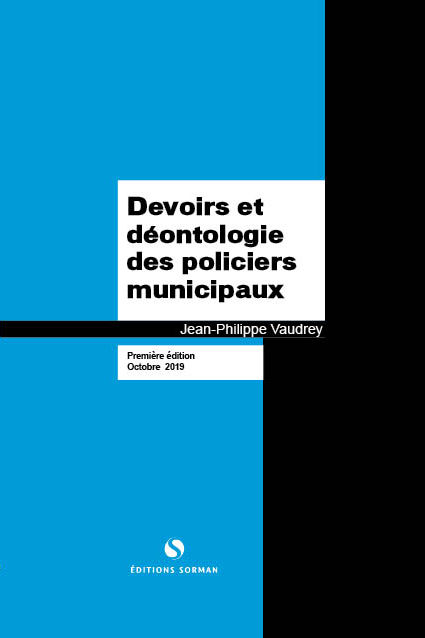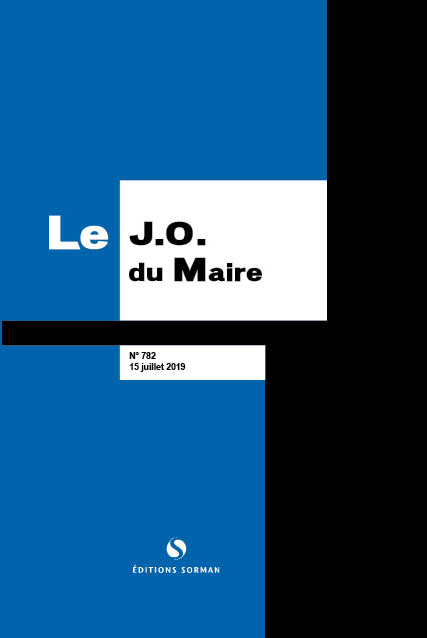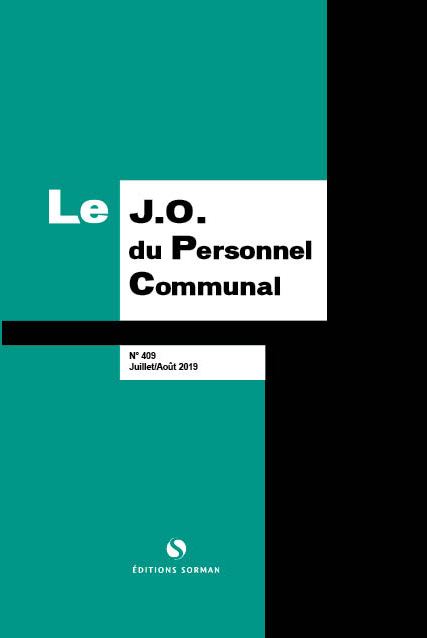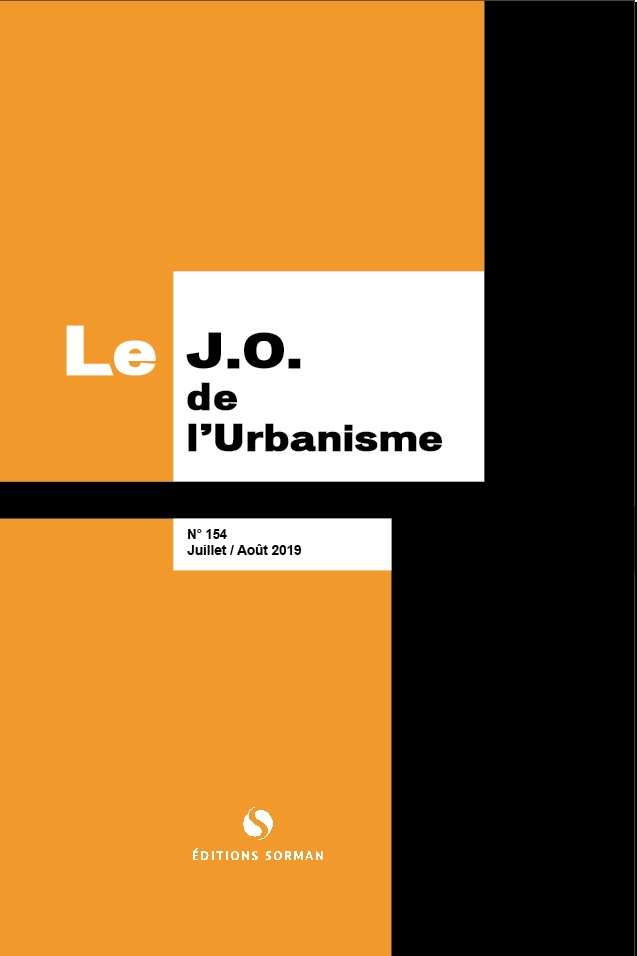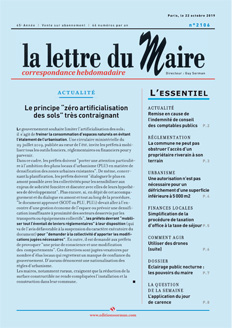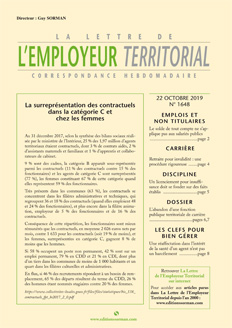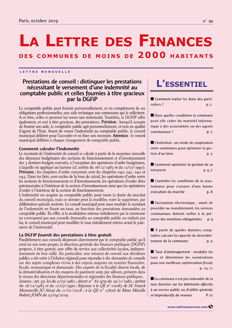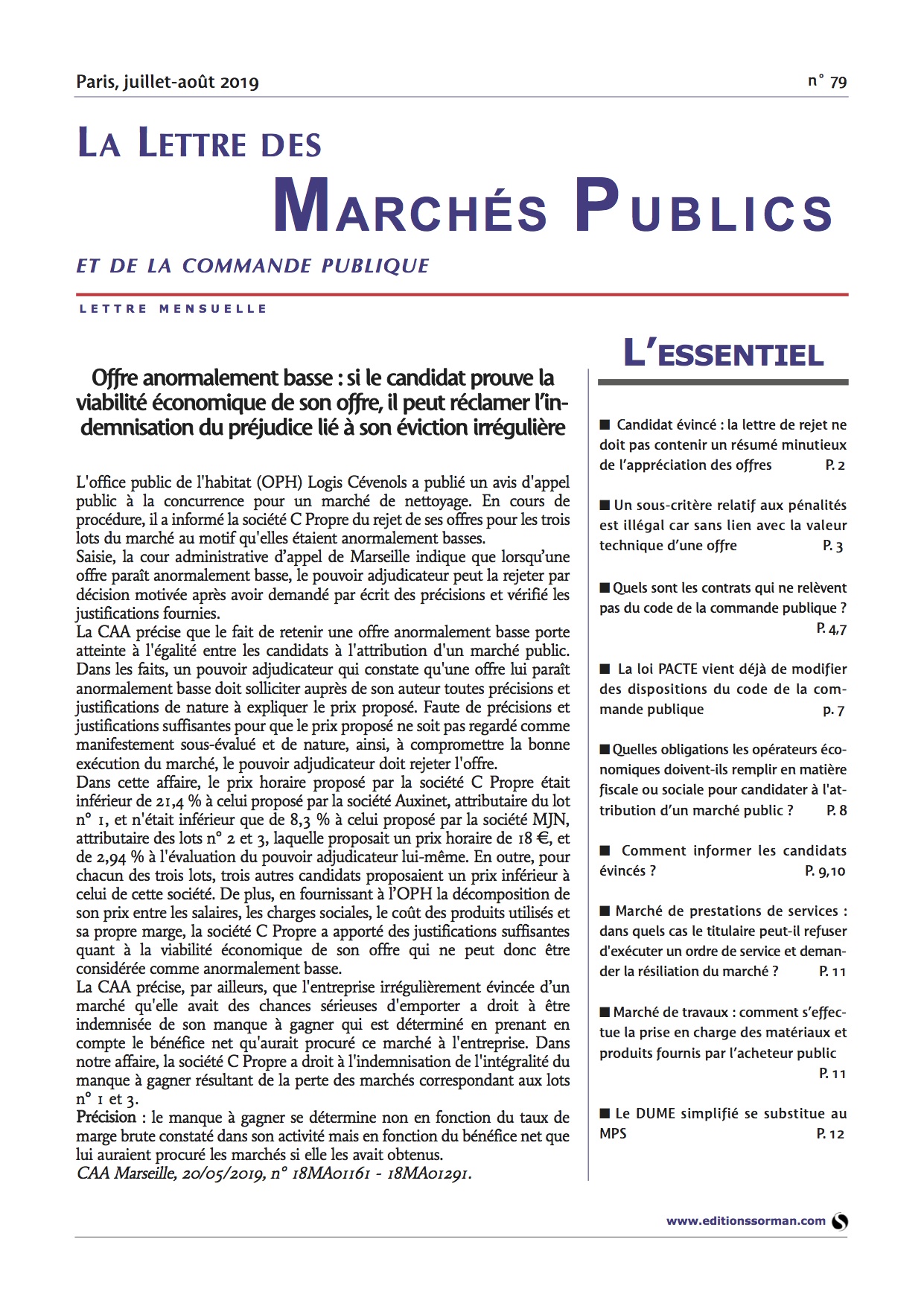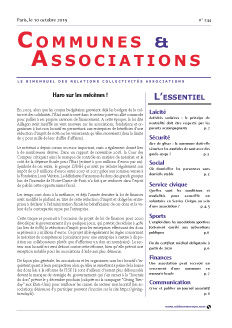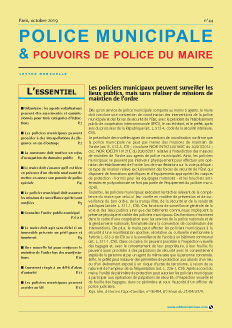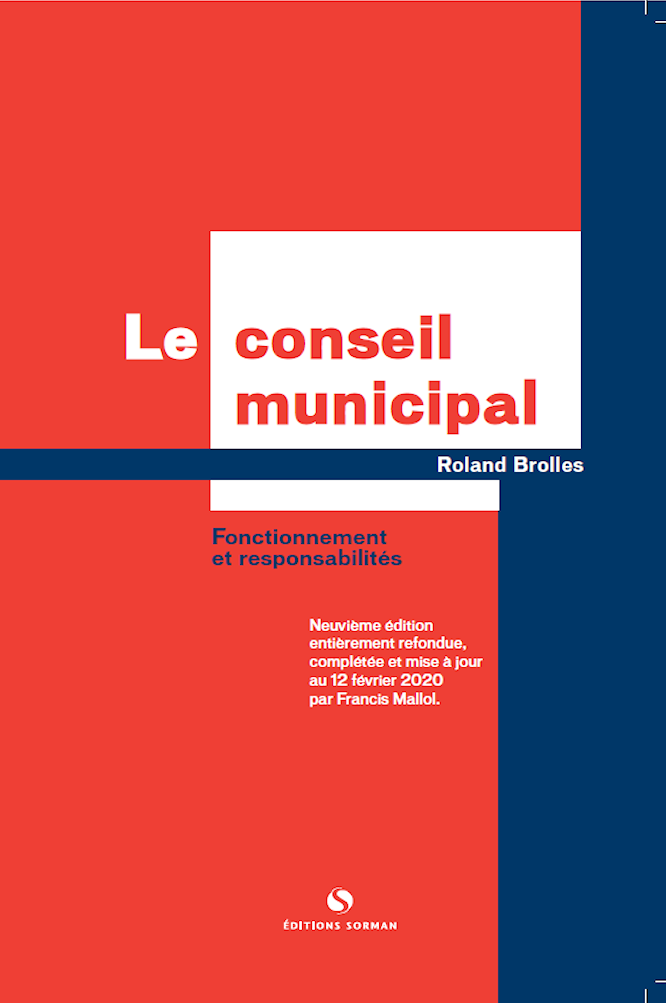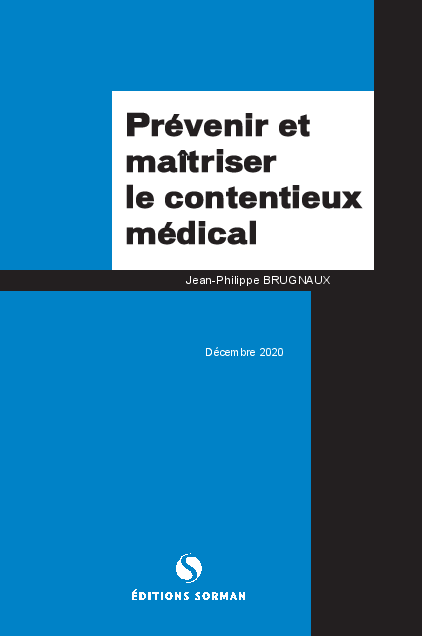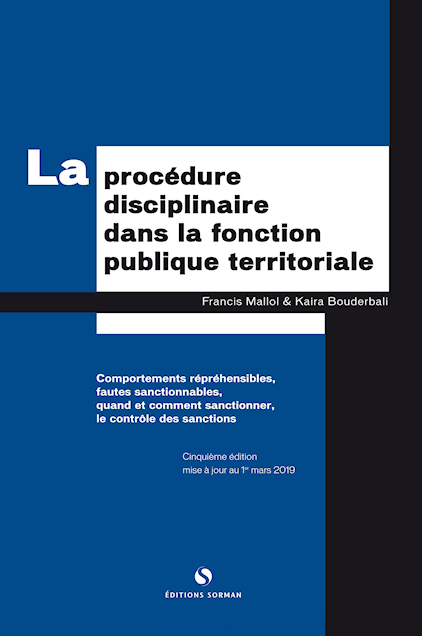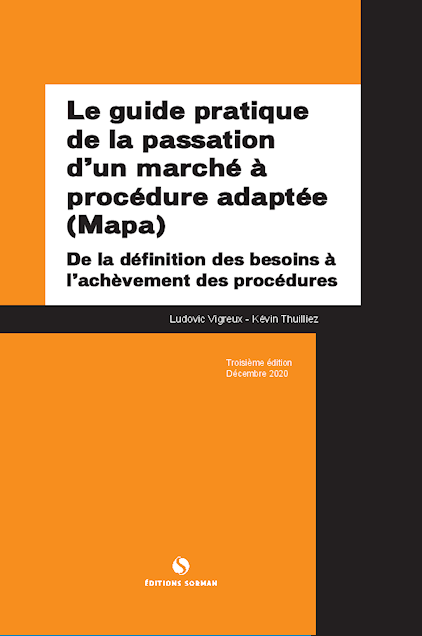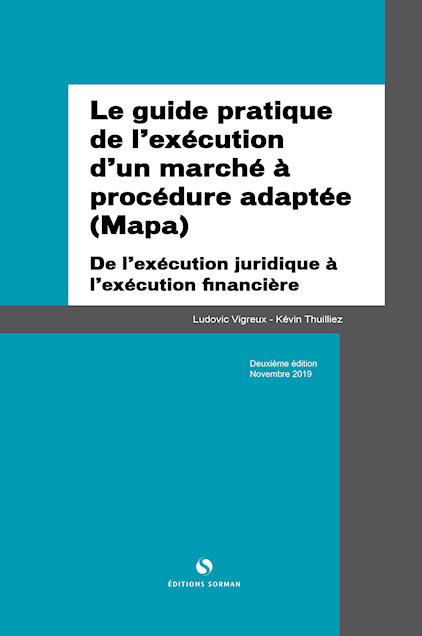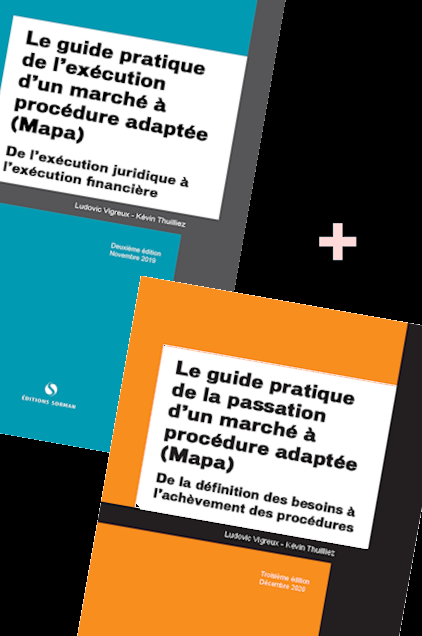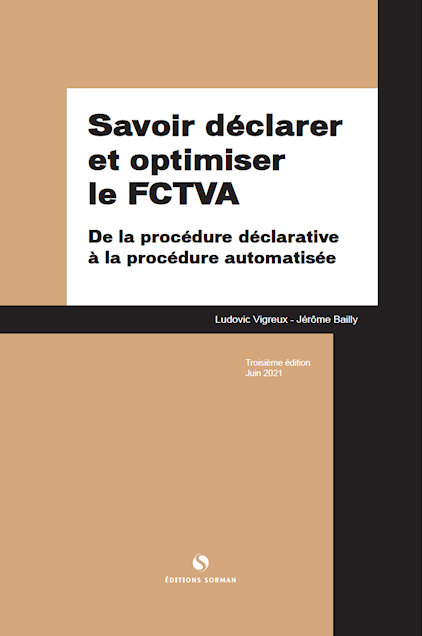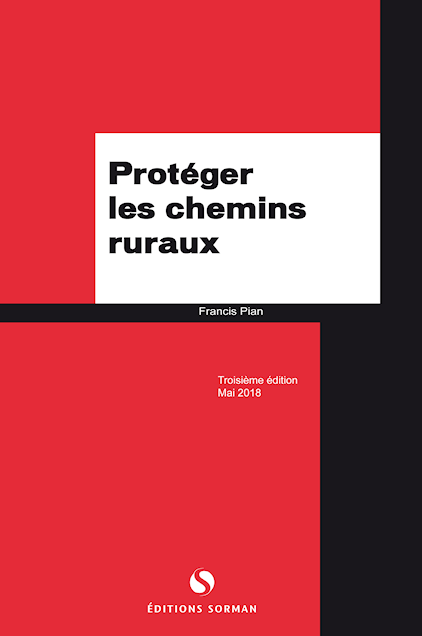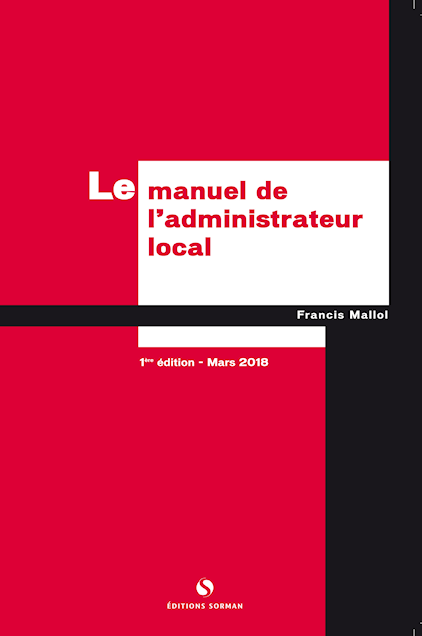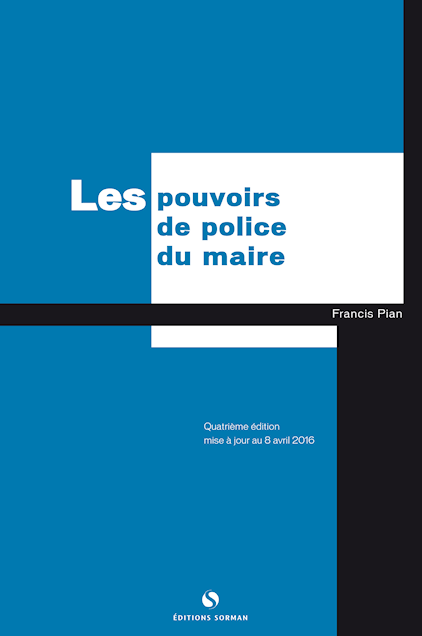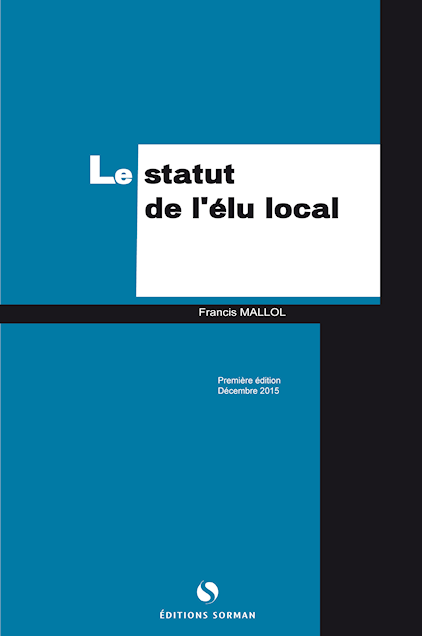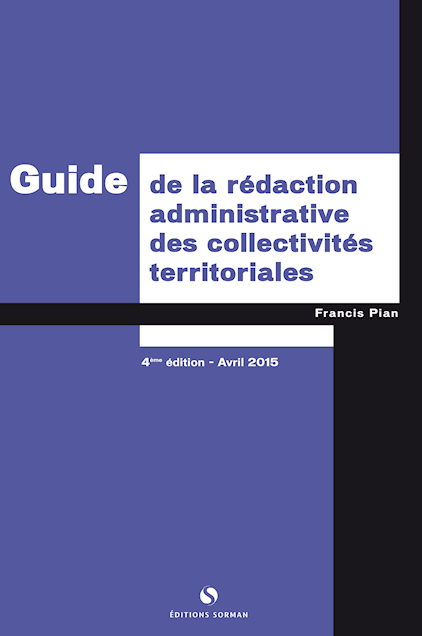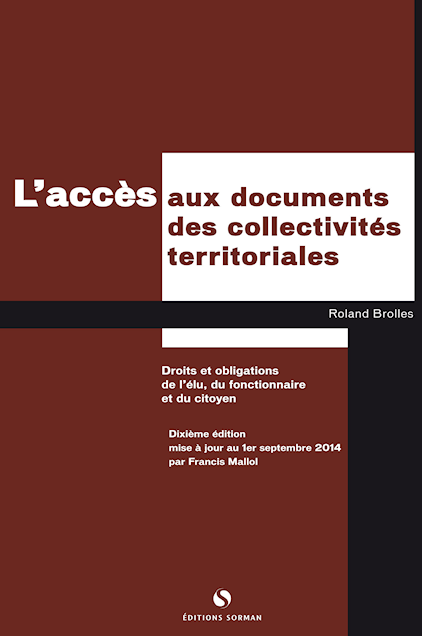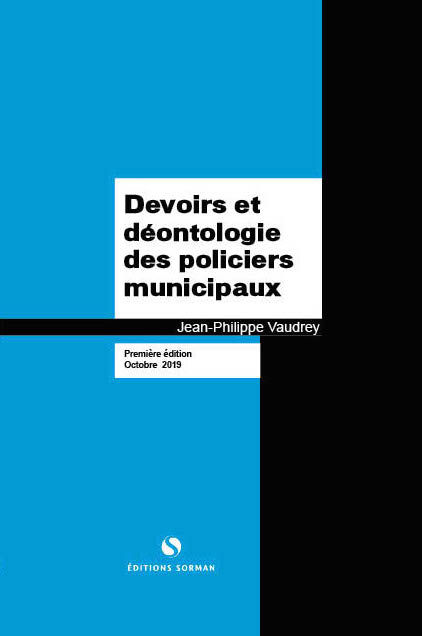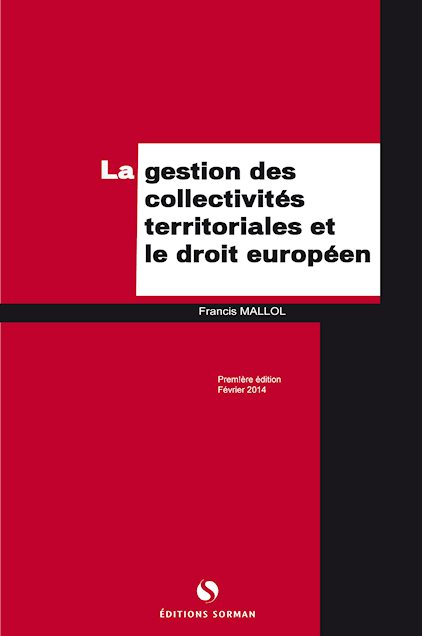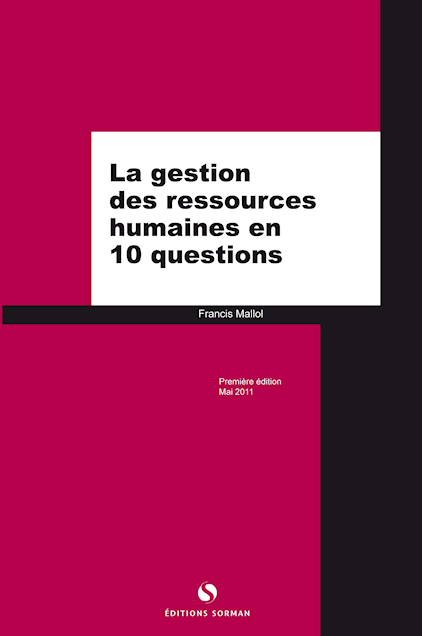Réduire la consommation d’eau sur son territoire Abonnés
La communauté de communes de la presqu’île de Crozon Aulne Maritime (Finistère, 24 073 habitants, dix communes dont neuf gérées par le service des eaux communautaire) a installé des compteurs sectoriels tous les dix kilomètres de canalisation. Ce maillage d’une cinquantaine d’appareils (6 000 € pièce) permet de détecter les fuites rapidement puisque les écarts de consommation significatifs, qui sont relevés durant la nuit, remontent chaque matin au service des eaux. Les techniciens peuvent alors localiser la fuite et réparer rapidement. A cette mesure s’ajoute la pose d’une trentaine de réducteurs de pression (10 000 € l’unité, génie civil compris). Ils divisent environ de moitié la pression de l’eau dans le réseau de distribution (qui est désormais de 3 à 8 bars selon les sites). « Cette mesure fait durer le réseau plus longtemps car il y a moins de contraintes liées à la pression, ce qui évite les fuites et réduit également le volume d’eau perdu en cas de fuite », explique Vincent Toussaint, responsable d’exploitation du service d’eau potable. Aucun impact perceptible, en revanche, pour les consommateurs lorsqu’ils ouvrent le robinet. Ces efforts, entamés il y a plus de dix ans, ont montré leur efficacité puisque le taux de rendement du réseau (ratio eau vendue/eau produite) a diminué de 75 % à 70,2 % entre 2011 et 2021.
Equiper les consommateurs
Au-delà des efforts de communication nécessaires pour éviter les gaspillages, certaines collectivités aident les ménages à adapter leurs comportements. C’est le cas d’Orléans Métropole (Loiret, 287 000 habitants, 22 communes) qui accorde une aide financière à l’acquisition de cuves de récupération d’eau. Depuis 2022, ce dispositif permet aux occupants d’une maison individuelle de stocker une partie des eaux pluviales (1 000 litres) pour des usages non alimentaires, comme l’arrosage des jardins. La mesure profite également à l’économie locale car le bon de réduction, d’un montant de 50 €, est valable uniquement dans les onze enseignes du territoire (jardinerie, bricolage…) qui ont signé une convention avec la métropole. La mesure est un succès, les bons disponibles lors des deux opérations organisées ont été épuisés en quelque jours. Au total, 2 500 bons ont été distribués, soit un coût total de 2 500 € pour Orléans métropole. Une date limite d’utilisation de trois mois a été fixée afin d’inciter les ménages à convertir leur bon en achats. « Le taux de conversion est de 50 %, ce qui est assez élevé », confirme la métropole, d’après les retours obtenus des enseignes participantes.
Attention : veillez, avec l’instauration d’une telle mesure, à ne pas déséquilibrer les comptes du service d’assainissement. En effet, ce dernier est alimenté financièrement en fonction des volumes d’eau potable qui sont facturés aux abonnés. Or, l’eau pluviale provenant des récupérateurs échappe à toute facturation mais se retrouve dans les réseaux d’assainissement. Son retraitement n’est donc pas financé.
Accompagner les changements de comportement
Économiser l’eau implique également d’inciter les abonnés à faire plus attention à leur consommation. C’est l’objectif d’une tarification progressive de l’eau, mesure inscrite dans le plan gouvernemental. A Muret (Haute-Garonne, 25 361 habitants), elle est en vigueur depuis 2012, lorsque la commune a mis un terme à la gestion déléguée de l’eau potable pour reprendre le service en régie municipale. Cela a permis de réduire de 40 % le prix de l’eau qui, depuis, est restée moins chère qu’ailleurs. Pour éviter les gaspillages, la commune a instauré une tarification progressive en six tranches. La première (moins de 25 m³ par an) est gratuite, puis les tarifs augmentent progressivement (jusqu’à près de 1,90 € par m³ hors taxes et abonnement). Pour une consommation moyenne de référence de 120 m³, la facturation unitaire est d’environ 3 €, assainissement compris. « Cette tarification a été un déclic, les consommateurs ont essayé de passer dans la tranche du dessous », se réjouit le maire, André Mandement. La moyenne des consommations a ainsi diminué de 14 % entre 2013 et 2022, et même de 29 % chez les professionnels, qui comptent parmi les dix plus gros consommateurs. La tarification progressive a apporté un bénéfice écologique mais aussi économique, comme l’explique l’élu : « par rapport à la croissance de notre population, la baisse des consommations nous a fait gagner dix ans puisque nous avons pu repousser de 2017 à 2027 un investissement d’un million d’euros dans une nouvelle usine d’eau potable ».
Jean-Philippe ARROUET le 23 mai 2023 - n°2273 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline