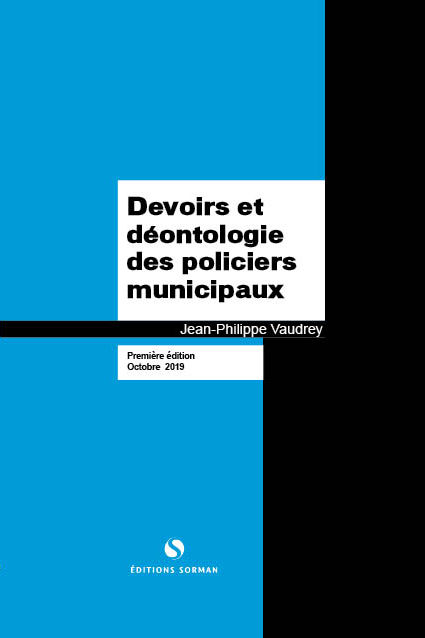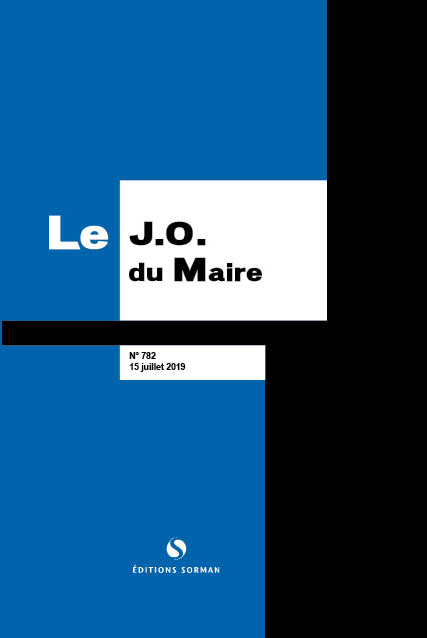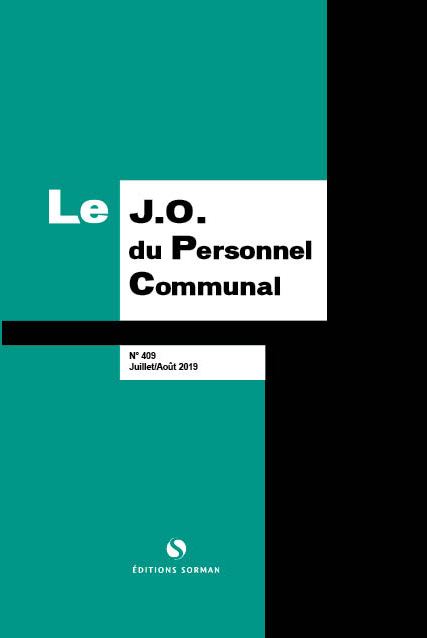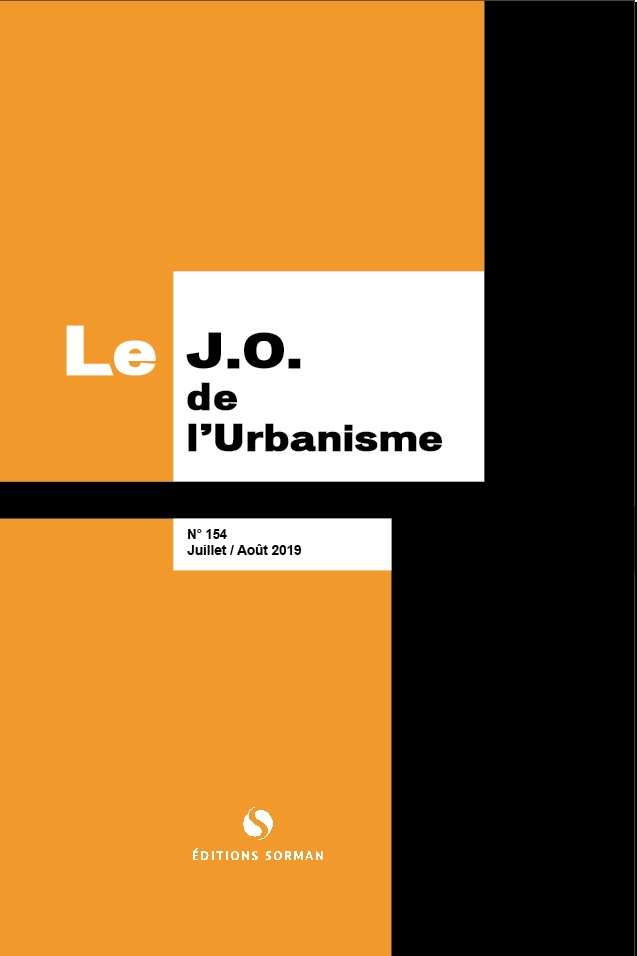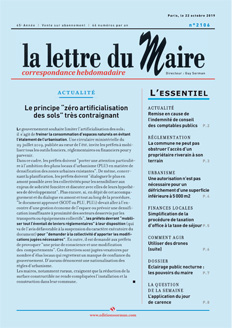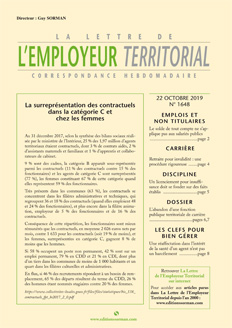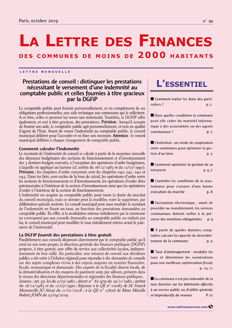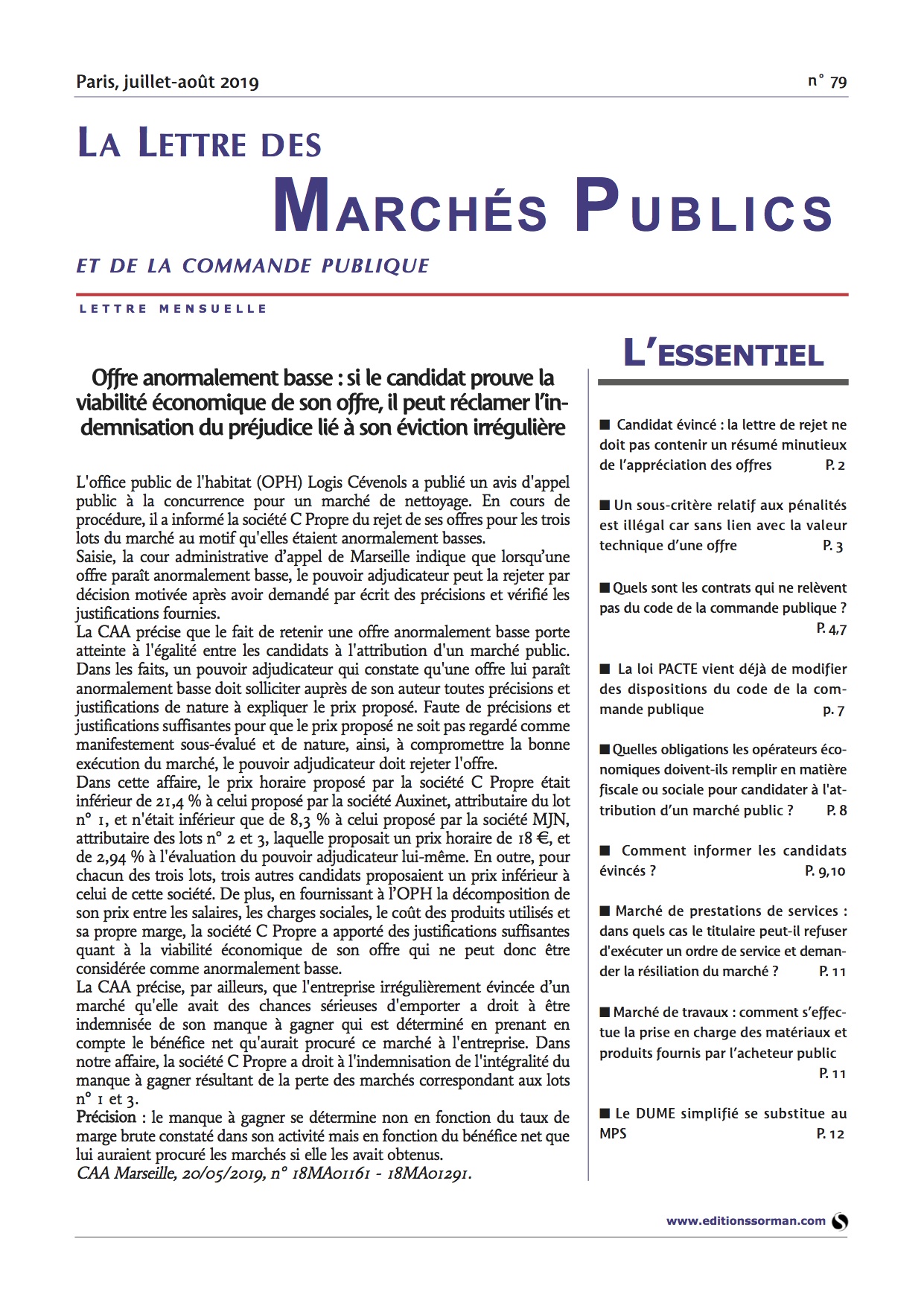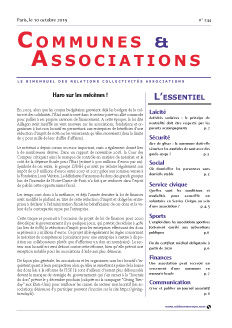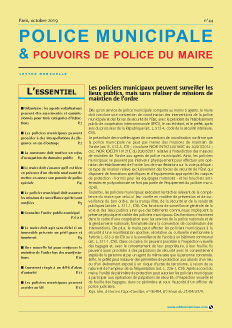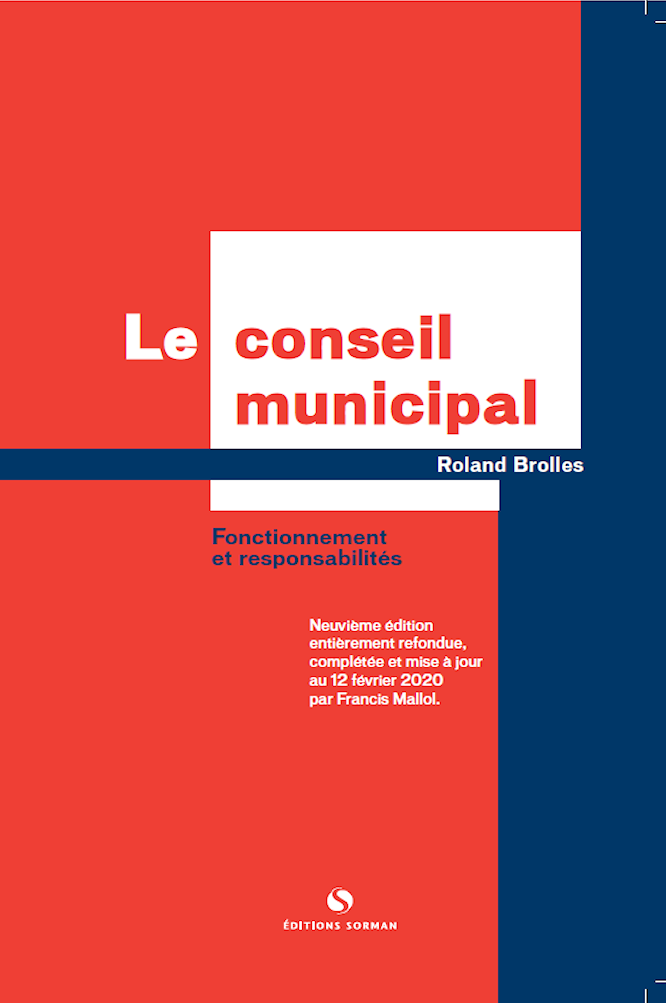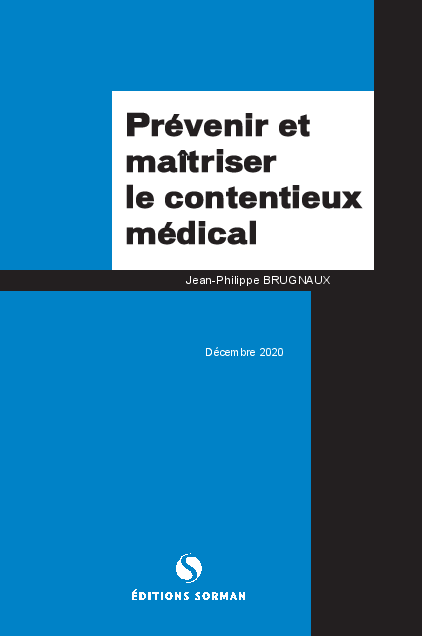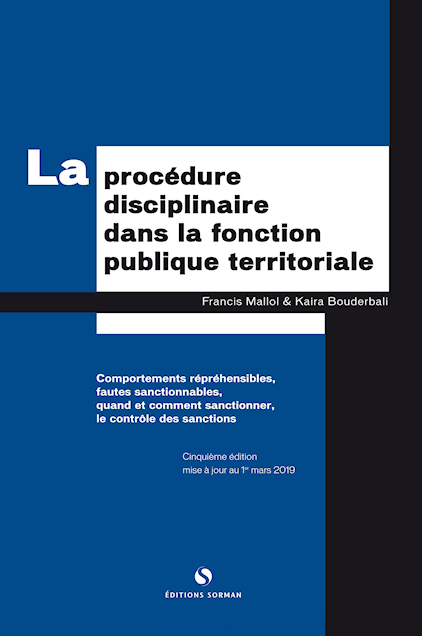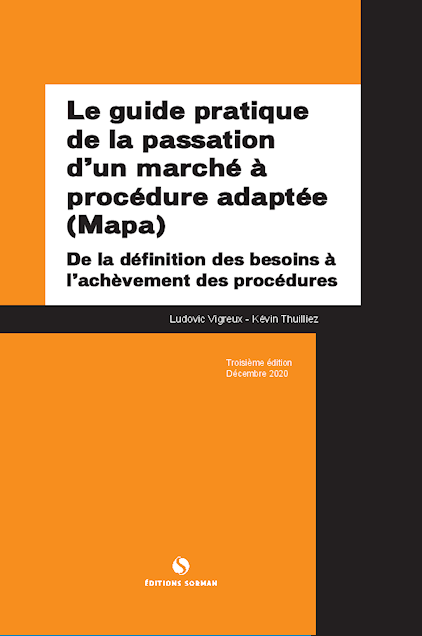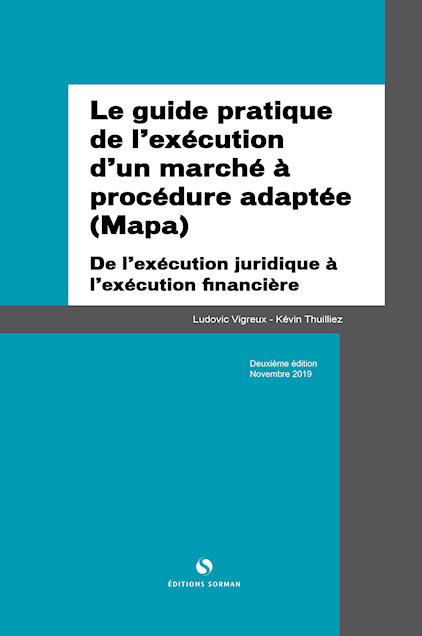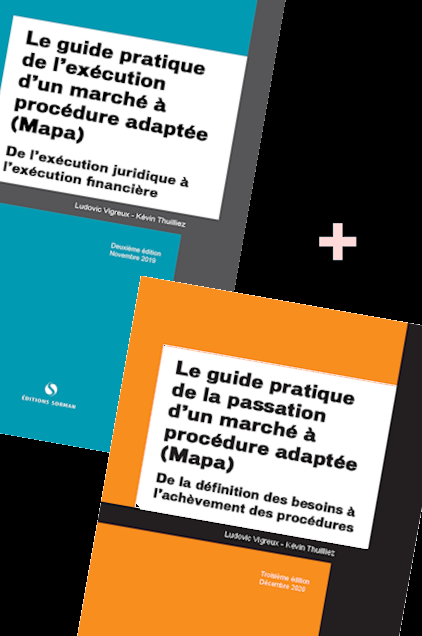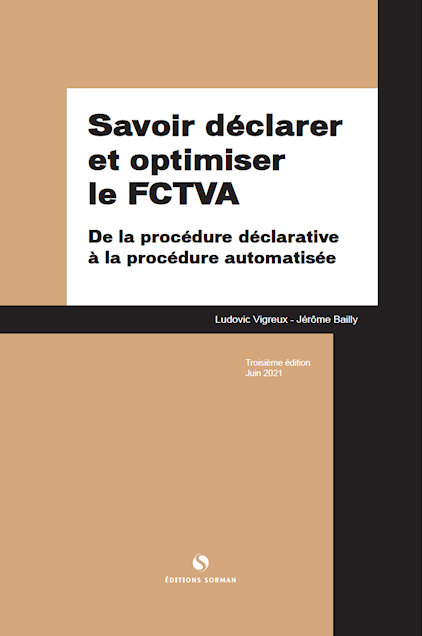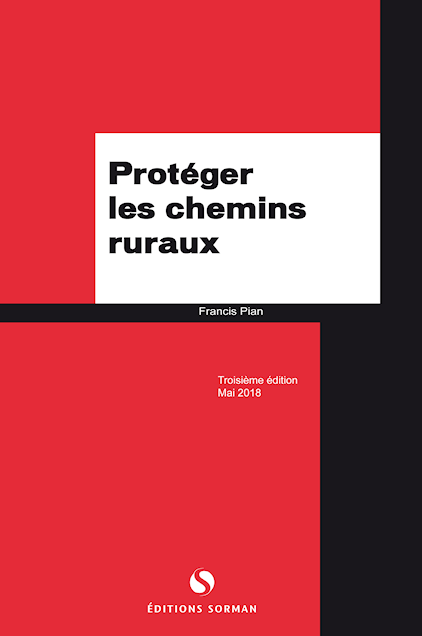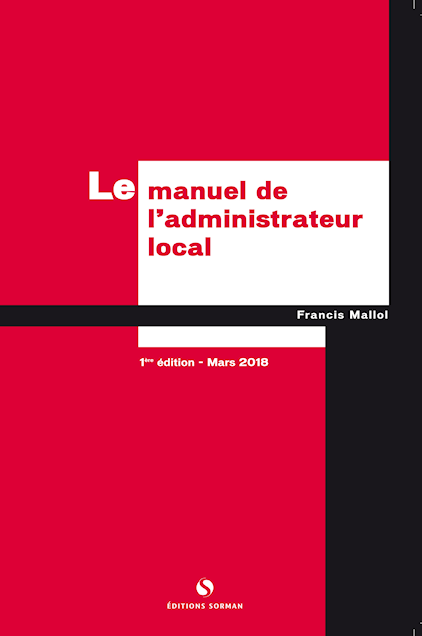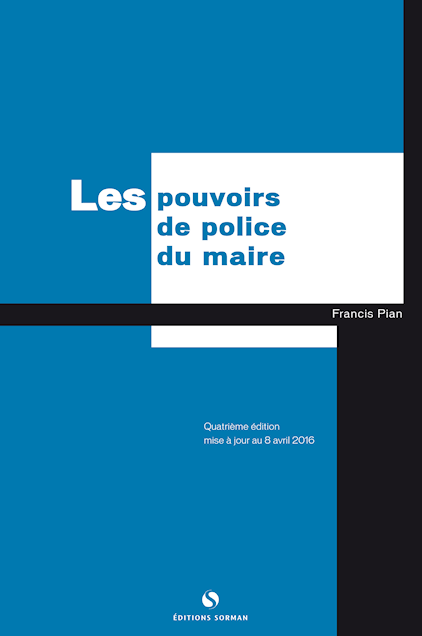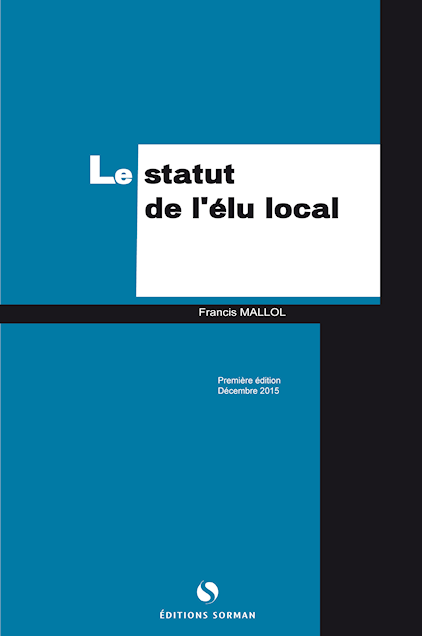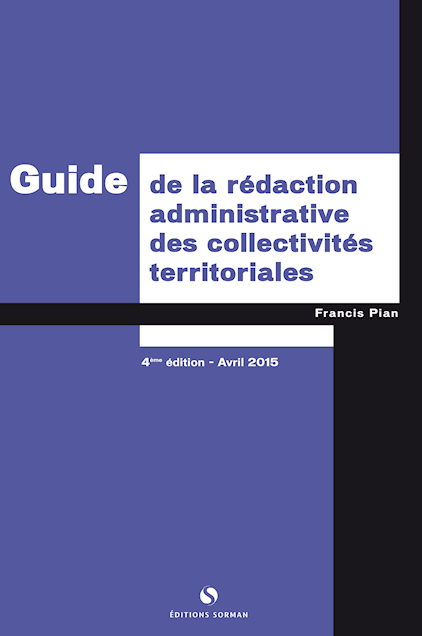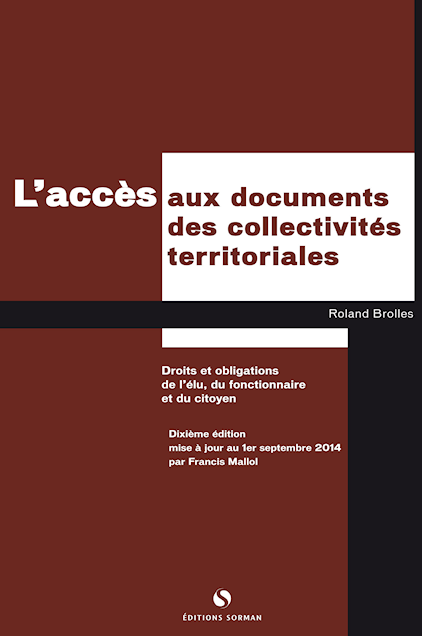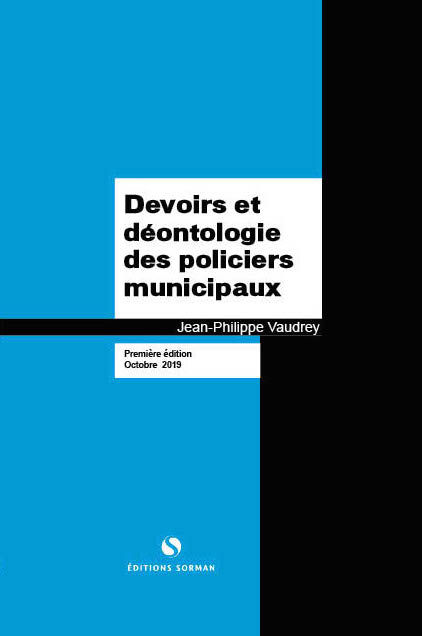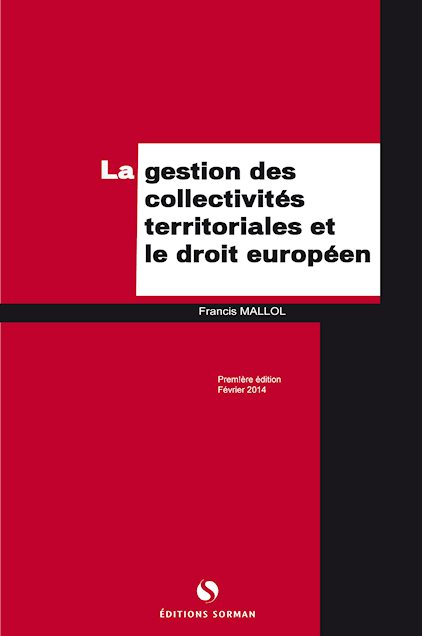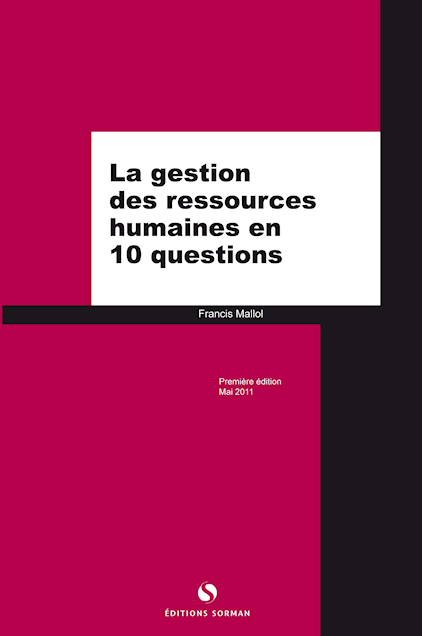Le numérique offre nombre de ressources encore inexploitées aux communes Abonnés
Entretien.
La Lettre du Maire : comment en êtes-vous venu à travailler pour les collectivités territoriales ?
Stephane Lelux : lors d’un service civique à Bruxelles en 1995, j’ai découvert l’évolution des télécommunications : d’abord la libéralisation avec l’entrée de nouveaux acteurs concurrents de l’opérateur historique (France Telecom) et le sentiment que cette libéralisation pouvait créer des inégalités entre les territoires : des métropoles très connectées et des territoires ruraux à l’écart du mouvement. C’est en pensant à cette fracture numérique et territoriale que j’ai créé Tactis, société de conseil basée à Vincennes mais qui travaille sur tout le territoire français, et même en Afrique (au Rwanda et au Maroc). Il existe une demi-douzaine d’entreprises sur notre secteur. Il a fallu mener un combat pour que les collectivités territoriales soient reconnues comme acteurs du numérique. Pour ne prendre qu’un exemple, la CNIL, jusqu’en 1996, estimait que la collectivité délégataire du service public n’avait pas son mot à dire sur les données collectées par son délégataire. Les choses ont changé.
La LDM : vous comptez donc des communes parmi vos clients ?
S.L : pas directement. Les services que nous proposons nécessitent une certaine expertise. Si la commune n’emploie pas un directeur des services informatiques performant, nos services peuvent paraître inaccessibles. Nous touchons les communes indirectement. Nous travaillons pour des syndicats d’énergie, d’eau ou ayant des compétences en matière numérique. Dans nos domaines, la mutualisation est idéale. Un exemple, en matière de videoprotection, nombreuses sont les communes, mêmes rurales, qui ont installé des caméras. Mais s’il n’y a pas d’agent pour regarder de manière continue ce que filment ces caméras, elles ne servent pas à grand-chose. La plupart des 35 000 communes de France n’ont pas les moyens d’installer un centre de surveillance. Aussi, la loi de sécurité globale* prévoit-elle que lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
Il peut mettre du personnel à disposition des communes concernées pour visionner les images. Le maire et la police municipale conservent donc leur compétence de police. Mais ils bénéficient de l’appui de l’intercommunalité. C’est, à mon avis, l’avenir. Dans l’Oise, par exemple, un syndicat mixte rend ce service accessible à 300 communes.
La LDM : vous affirmez que, jusqu’à présent, la vidéo a été conçue avec une approche sécuritaire mais que les choses doivent changer.
S.L : oui, et elles changent déjà. Les usages possibles sont multiples. La vidéo peut, par exemple, aider à la gestion du stationnement, identifier les voitures-ventouses qui restent longtemps immobilisées au même endroit. Elle peut aussi indiquer le nombre de passages sur une route de manière plus efficace que ne le font les câbles. La vidéo permet d’identifier la catégorie de véhicules, le nombre de fois où le même véhicule passe. Elle devient un instrument permettant de déterminer une politique de gestion de la voirie. La vidéo peut également permettre de sécuriser les abords des écoles, ou d’améliorer la gestion de l’eau quand on sait que 20% environ de l’eau captée sont perdus. Grâce à des capteurs installés sur le réseau, le gestionnaire du service peut savoir avec précision d’où viennent les fuites.
Autre exemple, la prévention des feux de forêt. Avec la multiplication des canicules partout en France, les feux de forêt ne seront plus cantonnés au sud de la France. Le département de la Sarthe en a pris conscience et installé des capteurs dans ses forêts, destinés à surveiller les départs de feu. Cela permettra de gagner un temps décisif pour stopper l’incendie, le SDIS n’aura pas à chercher le point de déclenchement. Un capteur vaut quelques dizaines d’euros, donc accessible à toutes les communes, même si je pense qu’il est préférable de constituer un syndicat qui, en achetant 300 capteurs plutôt que 30, obtiendra des tarifs plus intéressants.
*loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 modifiant l’article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure.
Michel Degoffe le 03 septembre 2024 - n°2329 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline