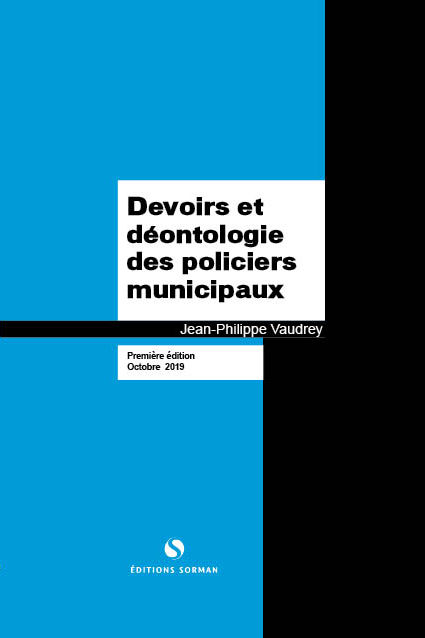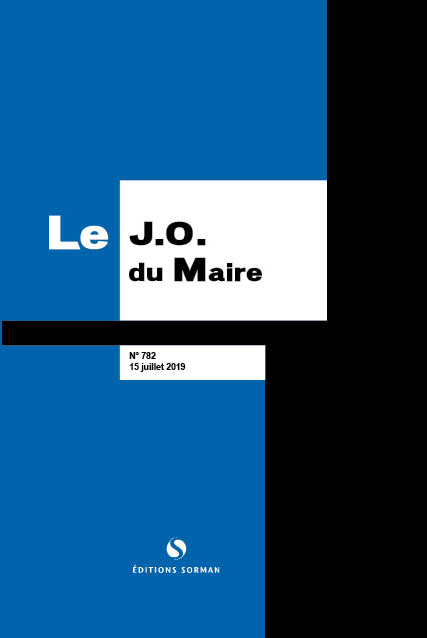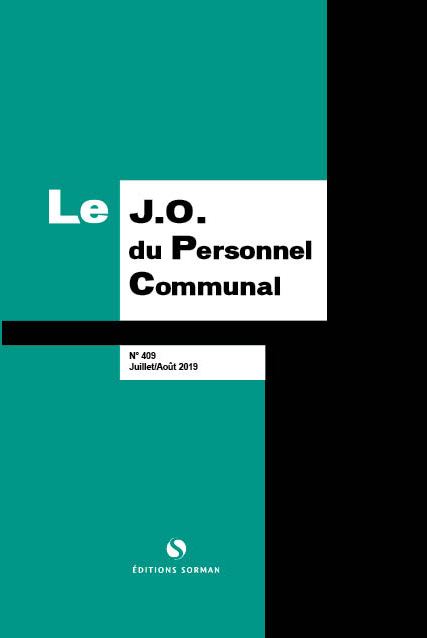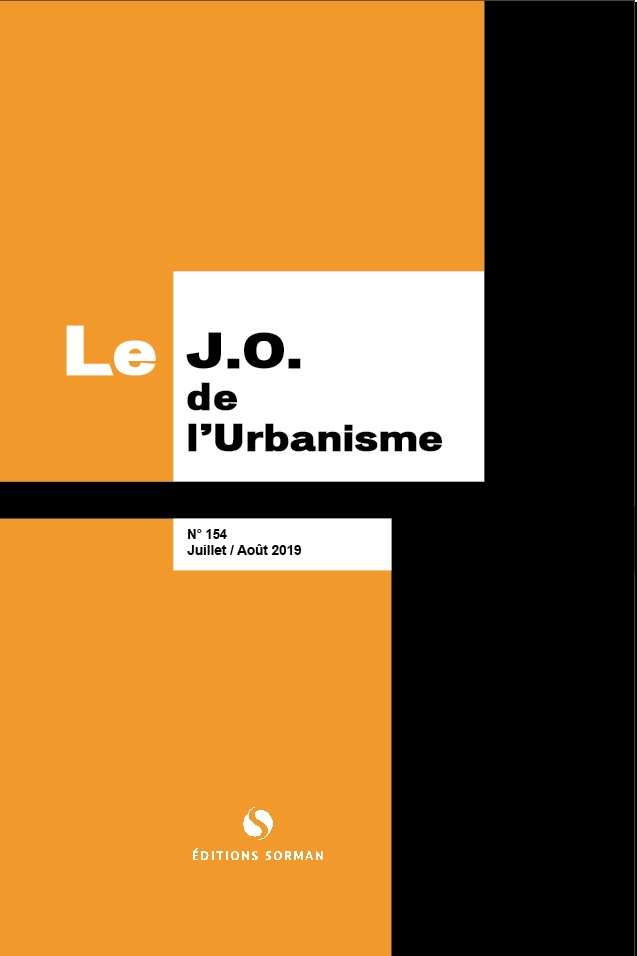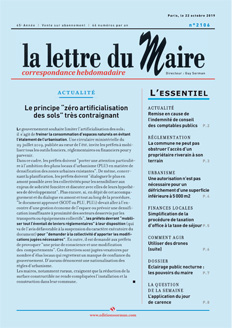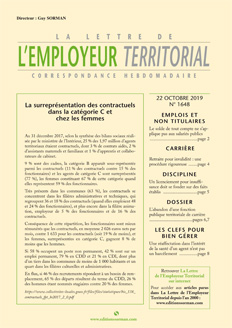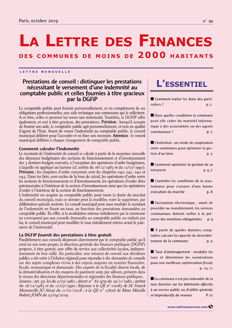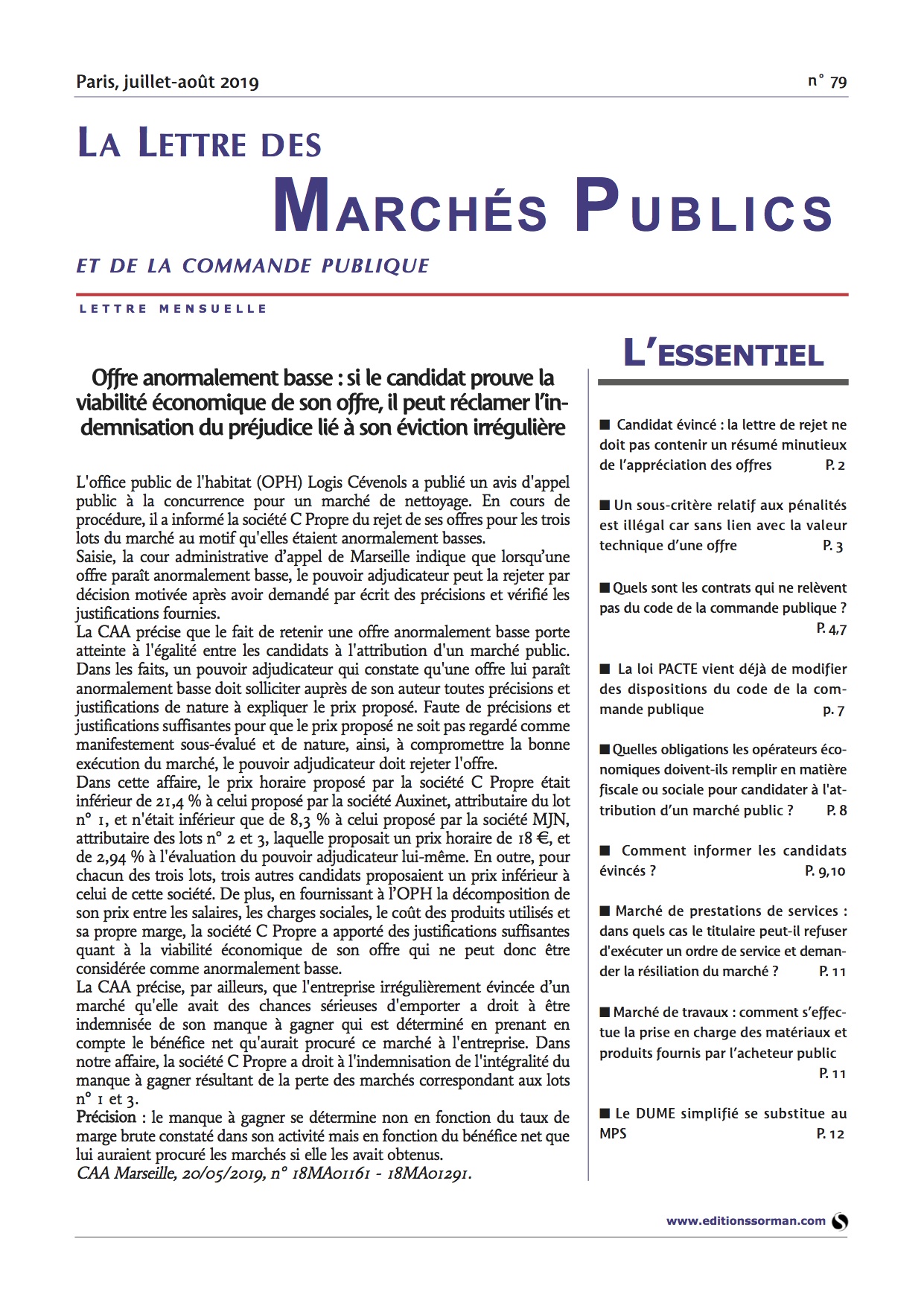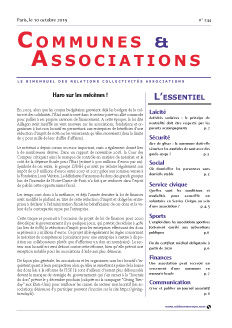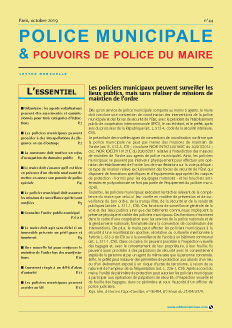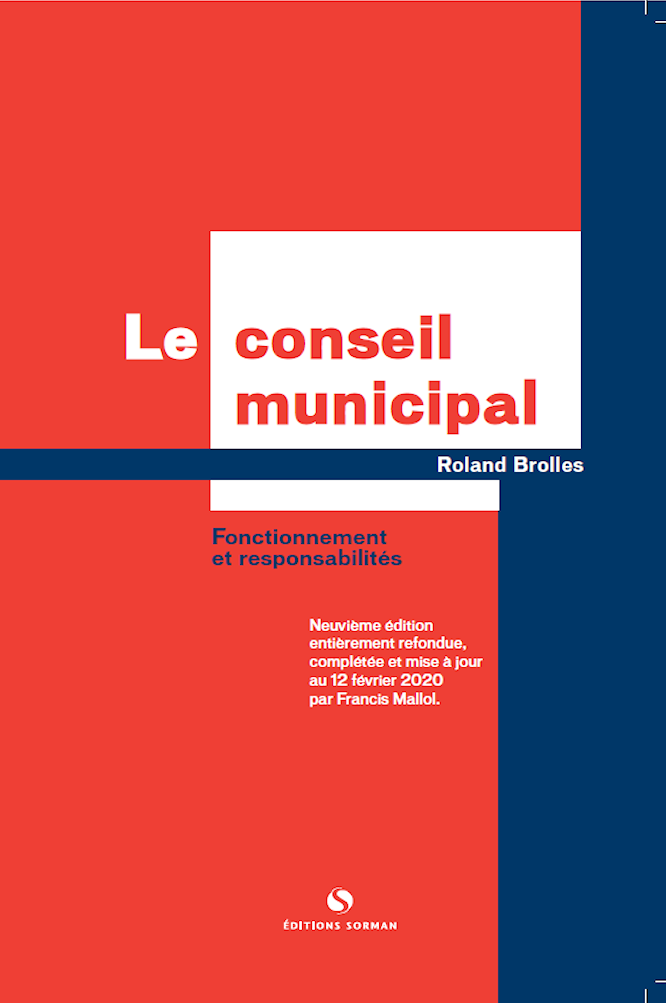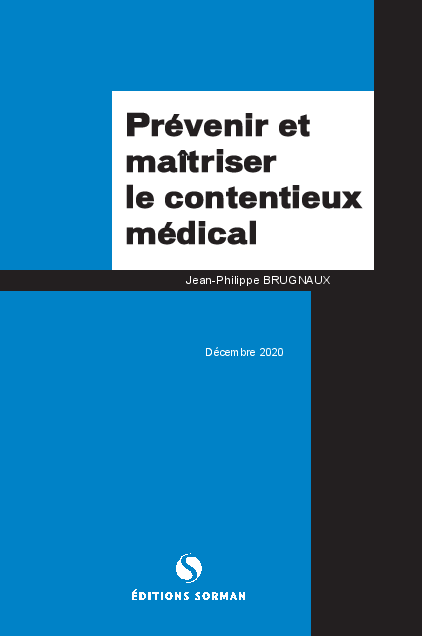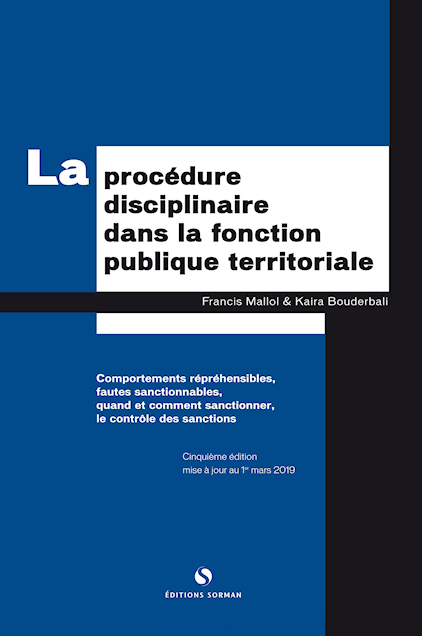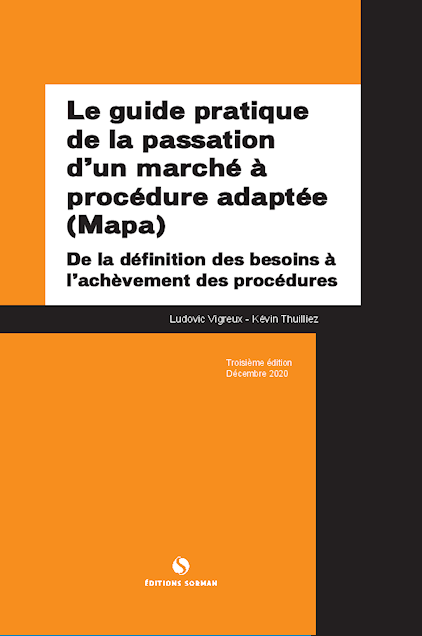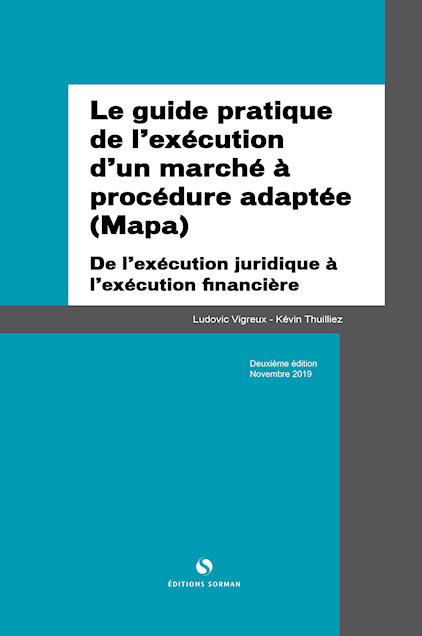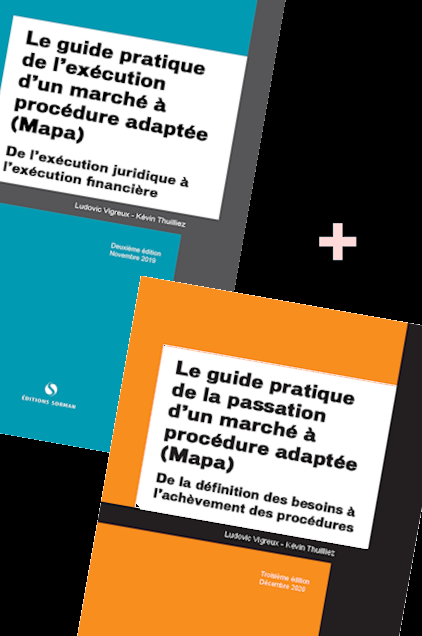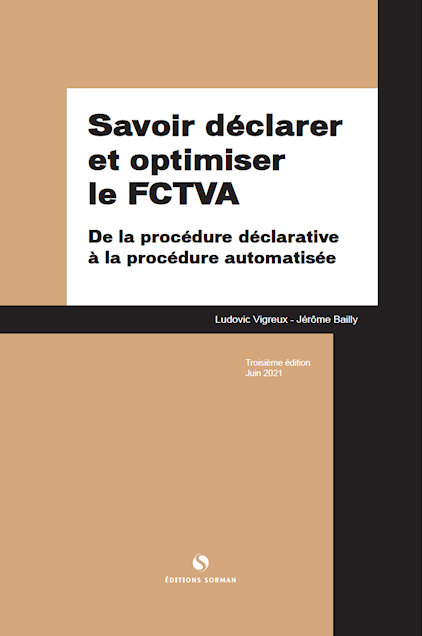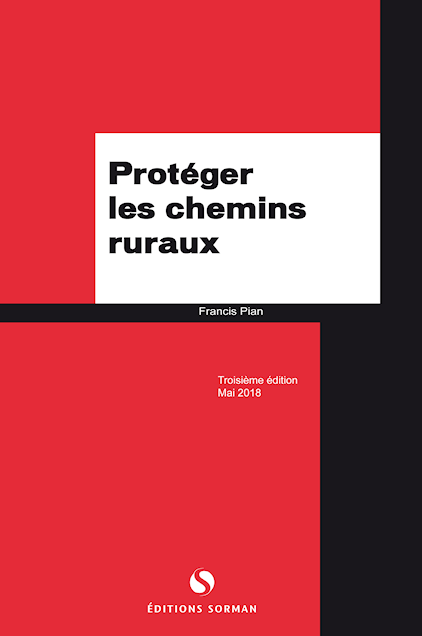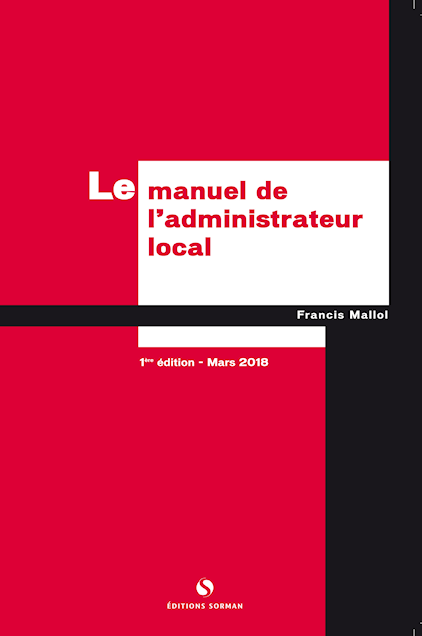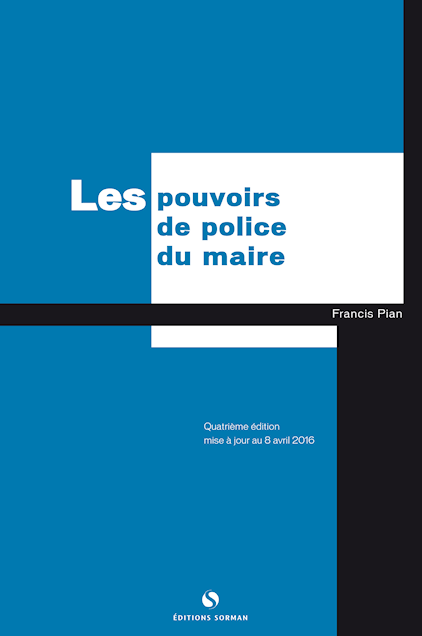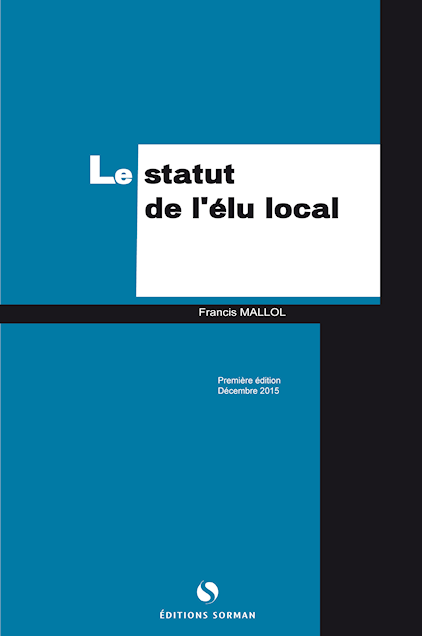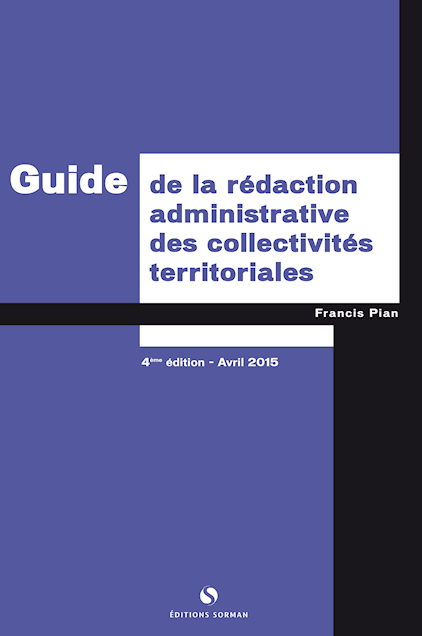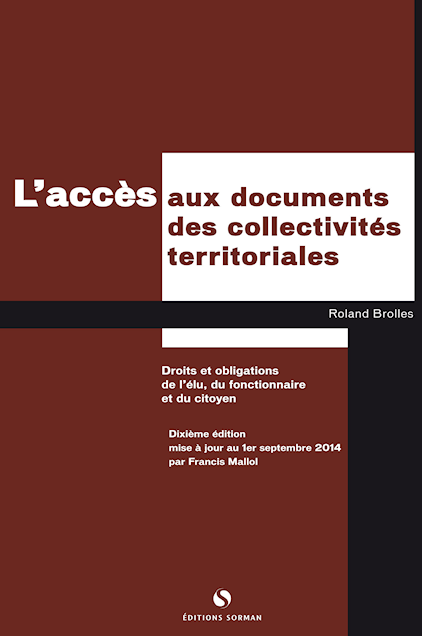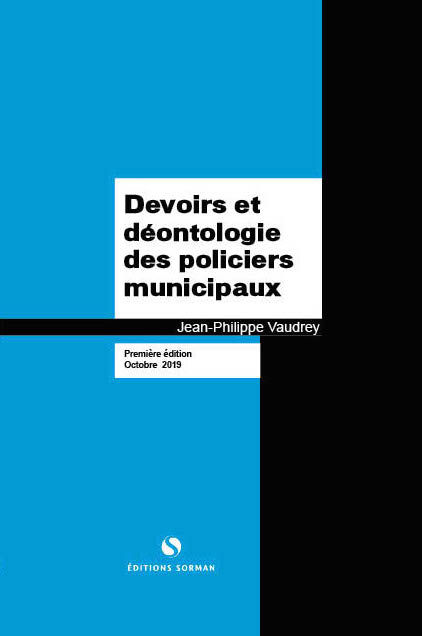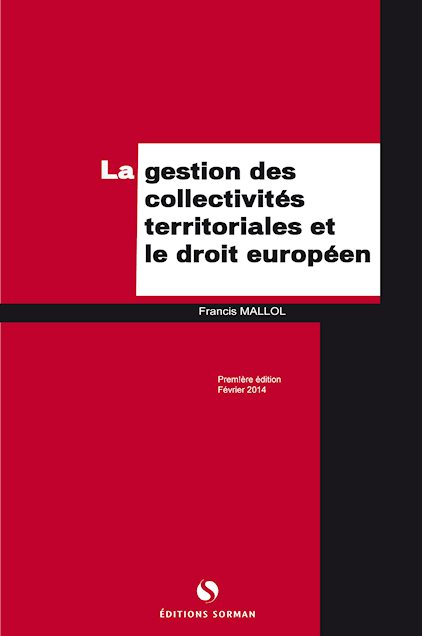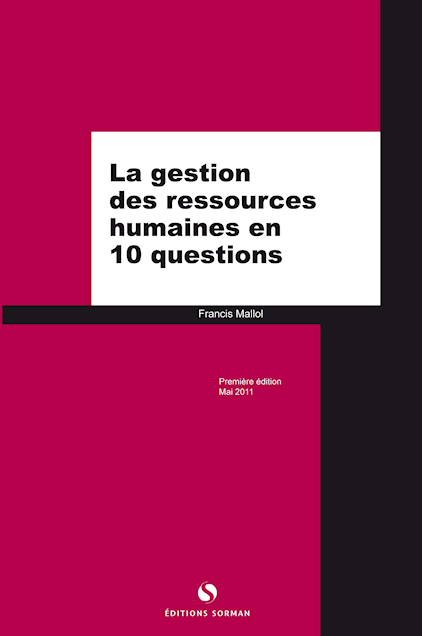Bien appliquer le régime des provisions Abonnés
Provisionner : une obligation ou une possibilité
Parmi les dépenses obligatoires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics figurent les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers (art. L. 2321-2, CGCT).
Les communes doivent ainsi constituer une provision dans les cas suivants (art. R. 2321-2, CGCT) :
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant, estimé par la commune, de la charge qui pourrait en résulter, en fonction du risque financier encouru ;
2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance, ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences du comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des informations communiquées par le comptable public.
En dehors de ces provisions obligatoires, on parle de provisions facultatives que le maire peut décider de constituer dès l'apparition d'un risque avéré. C’est par exemple le cas des provisions relatives à la monétisation des comptes-épargne-temps.
Notons que le maire peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
Les provisions semi-budgétaires : le régime de droit commun
Les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget (art. R. 2321-3, CGCT) : on parle alors de provisions semi-budgétaires. Ces dernières constituent une réelle mise en réserve des sommes provisionnées. Dans les faits, les services communaux doivent utiliser le chapitre 68 " Dotations aux provisions ". Pour la reprise de provisions, les services communaux ont recours au chapitre 78 " Reprises sur provision ".
Notons que le conseil municipal peut, par une délibération spécifique, décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. On parle alors de provisions budgétaires. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.
Attention, le passage d’un régime à un autre est possible en cas de renouvellement de l’assemblée délibérante, ou une fois par mandat.
En effet, s’ils optent pour les provisions budgétaires, la commune encoure le risque de voir utiliser la recette d’investissement pour financer une autre dépense que celle faisant l’objet d’une provision. C’est la traduction du principe budgétaire de l’universalité : une recette peut financer n’importe quelle dépense.
Le conseil municipal n’a plus à délibérer pour constituer une provision et en assurer le suivi
Depuis le 17 juillet 2022 (date d’entrée en vigueur du décret 2022-1008 du 15 juillet 2022 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales, à la péréquation des ressources fiscales, à la fiscalité locale et aux règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales), le conseil municipal ne doit plus délibérer pour constituer, ajuster, reprendre, voire étaler une provision.
Notons qu’il s’agit d’une nouvelle prérogative du maire ; l’acte administratif prend donc la forme d’un arrêté réglementaire, et non d’une décision prise par délégation du conseil municipal en vertu de l’article L. 2122-22 du CGCT.
Olivier Mathieu le 03 septembre 2024 - n°2329 de La Lettre du Maire
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline